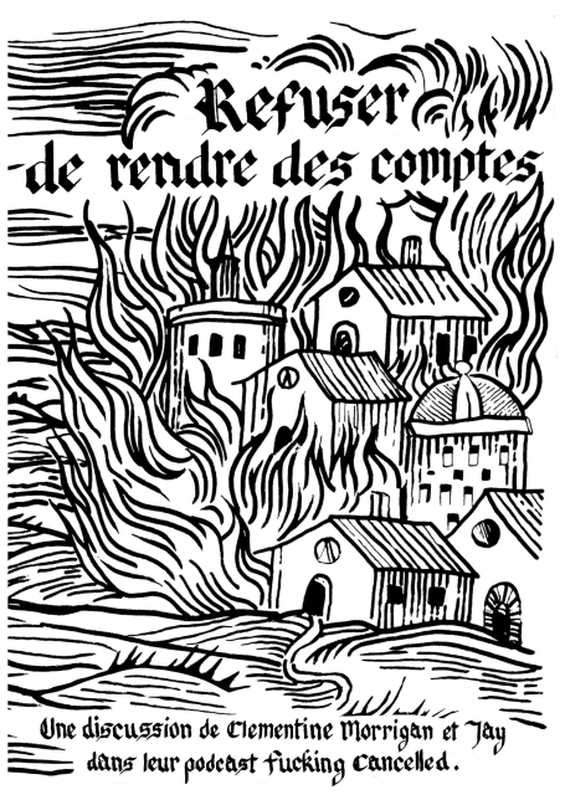Pour plus de confort, vous pouvez lire le texte au format PDF, qui offre une bien meilleure mise en page et des illustrations.
Avant-propos par l’équipe de traduction
Vous avez entre les mains la traduction de la transcription de l’épisode 6 du podcast Fucking Cancelled, intitulé Refusing Accountability. Il s’agit de la transcription d’une discussion : c’est du langage parlé. Nous traduisons depuis un contexte francophone européen, avec les pieds dans les milieux anarchistes, des liens avec les gauches radicales, et les orteils dans les milieux queer radicaux. Nous traduisons avec l’intention de questionner et décortiquer les évidences qui se tissent de temps à autre dans les idées et les pratiques de ces milieux.
Les deux concepts principaux sur lesquels se penche cet épisode, harm et accountability, n’ont pas de traduction exacte en français, en tout cas, il n’y a pas de concepts équivalents. Si ces mots n’ont pas d’équivalent exact en français, les situations qu’ils décrivent existent pourtant dans les contextes francophones européens. C’est notamment parce qu’en Europe dans les luttes féministes, queer, racisées, et handies, de nombreuses théories et pratiques viennent des milieux radicaux d’Amérique du Nord. Parfois c’est explicite, traduit et documenté et parfois c’est implicite, comme quelque chose qu’on se met à dire ou à faire sans bien savoir d’où c’est venu.
Le contenu théorique qui nous parvient des États-Unis passe souvent par de nombreuses transformations : traduction, republication, découpage du texte, reformulations multiples, citations raccourcies au maximum pour tenir dans un tweet, etc. Quand il nous parvient enfin, il nous semble souvent homogénéisé et consensuel, et s’appuyant sur des postures idéologiques non-questionnées et non-questionnables. Par exemple, impossible de complexifier la dichotomie victime/agresseure sans être accusé·e de blâmer les victimes, difficile aussi de parler de cancel culture* sans s’inscrire dans un débat dont le cadre et les termes sont entièrement définis et organisés par la droite pour nous nuire. L’immense majorité des critiques de ce contenu théorique vient de la droite et de l’extrême droite, et c’est terrifiant. Nous avons besoin de poser un regard critique sur nos pratiques en respectant nos valeurs d’émancipation pour tous et toutes.
Dans la discussion que Clementine et Jay ont dans ce podcast, on a trouvé du concret pour prendre la mesure de ce qui se passe quand on est face à des situations où des gens « se font du mal. » Iels décortiquent des conflits interpersonnels mineurs, qui ont pu nous arriver à tou·te·s, et nous permettent d’y voir plus clair. Iels abordent aussi des situations de violence grave en nous donnant des outils pour intervenir. Loin de nous faire la morale ou de nous indiquer un protocole universel à suivre, iels analysent ces exemples avec nuance et humanité.
A propos d’accountability, un concept au centre du texte : accountability signifie littéralement le proccessus de rendre des comptes. Nous l’avons traduit la plupart du temps par « rendre des comptes. » En théorie, ça désigne le fait de prendre en charge de manière autonome et non-punitive (sans la justice d’état ni la police) une situation d’injustice ou une situation dans laquelle une personne a fait du mal à une autre. Ce processus est pensé pour fonctionner dans des relations communautaires ou entre pairs. Il s’agit que la personne qui a causé des torts reconnaisse ses responsabilités auprès de la victime (et parfois auprès de la communauté que ça a impacté). Ça implique souvent de passer par de l’introspection, des excuses, faire amende honorable* et changer les comportements qui ont été préjudiciables. Ce processus peut être provoqué par une intervention de l’entourage et c’est fondamental que la personne s’y prête volontairement. En pratique, dans les contextes qu’évoquent Jay et Clementine, cette théorie offre un cadre moral que des personnes peuvent utiliser pour exercer une punition ou une vengeance. Par manque de perspectives ou d’outils, des personnes se retrouvent souvent à essayer d’obtenir ce processus par la contrainte. C’est fréquent qu’on exige des personnes qu’elles s’engagent dans ce processus seul·es et dans l’urgence. Quand le concept d’accountability est invoqué à tort il peut mener à d’avantage d’escalade et de violence (campagne d’ostracisation, harcèlement, dépossession de son histoire, etc.)
La question des violences et des manières dont on y réagit est une question difficile, clivante, saturée d’enjeux politiques, culturels et émotionnels. Nous espérons que la diffusion de ce texte permettra d’ouvrir des perspectives pour nous saisir de ces enjeux, les explorer, en parler, agir.
Bonne lecture ♥
Glossaire et éléments de contexte
Cancel culture : parfois traduit par « ostracisation »/« ostraciser. » Nous avons choisi de ne pas traduire systématiquement « cancel » par « ostraciser. » L’ostracisation est une des punitions qui peuvent être utilisées dans la cancel culture, mais dans ce texte « cancel culture » fait aussi référence à d’autres punitions, au cadre idéologique qui pousse à vouloir punir.
C’est en 2015 dans la communauté noire étasunienne que l’expression « cancel quelque chose/quelqu’un.e » est devenue populaire sur Twitter. Cela décrivait le fait de cesser complètement de soutenir une marque, une célébrité ou une entreprise, pour des raisons politiques. A la même période, les cas de harcèlement de groupe en ligne et d’humiliations publiques sur les réseaux sociaux ont explosé. Le mot « cancel » nommait alors la vague de réactions négatives qui déferle en masse sur une cible unique, suite à une simple déclaration sur Internet. Constatant l’essor de cette pratique, on a alors parlé de « cancel culture, » car il s’agit bien d’une pratique culturelle.Il a fallu attendre 2020 pour que la droite conservatrice étasunienne se saisisse de l’expression « cancel culture » pour nommer toute réponse de la gauche et des militant·es pour la justice sociale face à leurs discours réactionnaires ou discriminants. C’est à ce moment là que les droites françaises et européennes ce sont saisies de cette expression, et c’est pour cette raison qu’aujourd’hui quand nous entendons « cancel culture » en France c’est souvent dans les médias de masse et ou dans les discours de personnalités de droite pour qualifier, par exemple, les mouvements militants décoloniaux qui déboulonnent des statues d’esclavagistes ou encore la vague de call-outs ayant émergé après #MeToo.
Depuis 2015 plusieurs militant·es et auteur·ices nord-américain·es produisent des textes et du contenu théorique critique de la cancel culture, d’un point de vue anarchiste ou socialiste, féministe, décolonial et queer. Certain·es utilisent d’autres termes pour nommer ce phénomène (culture du call-out, culture du jetable). Jay et Clementine s’inscrivent dans ce courant.
Communauté : en anglais, « communauté » n’a pas tout à fait le même sens qu‘en français. En français, il va décrire la plupart du temps des groupes de personnes issues d’une diaspora ou des groupes LGBTI. Il y a donc cette idée que les communautés sont des groupes de personnes minoritaires dans la société. En anglais, community a un sens très large et désigne tous les groupes humains dans lesquels s‘inscrit une personne. Ça peut se rapprocher des notions de collectif, de commun. On peut donc parler de « communauté » pour désigner les habitant·es d’une ville, d’un village, d’un quartier où on vit, autant que pour parler d’un groupe avec lequel on a une histoire commune, des activités ou des passions communes, avec lequel on a une activité spécifique, avec lequel on s’organise politiquement… Parfois ça désigne ce qu’en français on appellerait « la société. » On a choisi de traduire par « communauté, » il faut donc avoir en tête le sens anglais quand on lit. On a occasionnellement traduit par « société » ou « collectif » quand ça s’y prêtait bien.
Identitaire/identitarisme : « identitaire » est un terme parapluie qui qualifie tout les mouvements politiques articulés autour de l’appartenance d’un groupe à une identité commune, et ayant pour but de promouvoir ou défendre cette identité. En France nous l’utilisons souvent pour nommer une partie de l’extrême-droite anti-immigration.
Ce qui nous intéresse dans le contexte de cette brochure, ce sont les mouvements identitaires qui sont issus des identity politics (politique des identités). Il s’agit d’un courant qui a émergé dans les années 70 aux Etats-Unis. Son apparition est attribuée au groupe socialiste féministe Noir Combahee River Collective (et notamment à l’une de ses membres fondatrices, Barbara Smith) face à l’absence de pertinence du féminisme universaliste pour les femmes noires. Ce courant défend l’idée que la lutte doit se faire à partir des expériences vécues par les individu·es victimes d’oppressions systémiques. Le féminisme intersectionnel ainsi qu’une bonne partie des luttes féministes, queer, handi et antiracistes d’aujourd’hui sont l’héritage des identity politics.
Ces dernières années, ces courants sont marqués par une individualisation grandissante : la tendance qui domine ramène majoritairement les enjeux d’oppression à des comportements individuels (par exemple : se situer, checker ses privilèges, se sentir légitime… plutôt que de chercher à élargir et rendre collective la lutte contre toute forme d’oppression) et à des problèmes interpersonnels (par exemple : focaliser sur la lutte contre les comportements racistes, sexistes, etc. plutôt que contre le racisme et le sexisme en tant que systèmes). Il y a une condamnation du privilège personnel et une focalisation sur la souffrance liée à l’oppression qui crée une sorte de système de valeur où les plus opprimé·es sont les plus méritant·es. Il y a la tendance à perdre de vue que les oppressions sont liées au maintien du capitalisme et des pouvoirs institutionnels qui assurent sa continuité.
Les critiques de ces mouvements mettent souvent en avant que les théories et pratiques identitaires de gauche se perdent dans des pratiques centrées sur l’individu, et que cela ancre la culpabilité et la souffrance individuelles au lieu de révéler le pouvoir collectif d’action, de création et de lutte. On note que cette tendance à l’individualisation est majoritaire dans les milieux radicaux nord-américains, et que c’est assez différent en Europe même si ces idées et pratiques y sont fortement présentes et s’y implantent de plus en plus.
Clementine et Jay font partie des personnes critiques de cette tendance à l’individualisation. Quand iels parlent d’identitarisme, ce sont de ces mouvements-là dont iels parlent.
Programmes en 12 Étapes : programmes d’entraide entre pair·es sur lesquels sont par exemple basés les Alcooliques Anonymes et les Narcotiques Anonymes. Les 12 étapes sont un cadre qui permet de créer une structure, des groupes de parole et une relation de mentorat (« sponsor » en anglais, « parrain·marraine » ou « système de parrainage » en français) pour travailler à réparer les conséquences de l’addiction sur le quotidien, les relations, la vie.
Faire amende ou faire amende honorable : Dans les Programmes en 12 Étapes, les personnes sont encouragées à réparer les torts qu’elles ont causé au travers d’un processus nommé « faire amende honorable. » Cela signifie « changer les choses en vue de les améliorer. » En français, le texte qui sert de base à ces programmes a traduit ce concept par « réparer nos torts. » Nous traduisons par l’un ou l’autre.
Socialisme : Hors de l’Europe, ce terme prend une autre signification que celle que nous pouvons connaître en France par exemple. Pour comprendre de quoi parlent les personnes dans ce texte lorsqu’elles utilisent ce terme, il faut parler de l’histoire des idéologies socialistes.
Le socialisme est un courant de pensée qui a pu prendre des formes philosophiques et politiques. Le mot est utilisé couramment à partir des années 1820. À la base du socialisme, il y a l’aspiration à un monde meilleur pour tou·te·s, et cela passe par, au minimum, la réduction des inégalités, et au mieux, l’établissement d’une société sans classes sociales. Le XIXe siècle occidental est globalement porté par la notion de « progrès, » et selon les socialistes, le progrès doit être tourné vers la condition humaine. Il en découle les idées de gérer les ressources dans l’intérêt collectif, pour en garantir l’accès à tou·te·s, d’en finir avec l’exploitation de l’humain par l’humain. Cela peut passer par la propriété sociale des moyens de production, c’est à dire que tout le monde a accès aux ressources et aux outils permettant de les transformer.
Jusqu’au début du XXe siècle, les courants socialistes sont en majorité anarchistes. Ils sont peu à peu supplantés par le courant marxiste. Le marxisme est une forme du socialisme qui se veut scientifique : son but est de théoriser les modalités et l’avènement du socialisme. Le marxisme met en avant une société communiste, c’est à dire une forme d’organisation sociale sans classe, sans État et sans monnaie, où les biens matériels sont mis en commun et partagés. La révolution d’octobre 1917 en Russie marque une scission avec cette théorie et l’avènement du communisme d’État.
En Europe occidentale, le socialisme a pris un tournant réformiste à la fin du XIXe siècle, avec des courants qui ont progressivement opté pour la social-démocratie et se sont organisés en partis politiques entrant dans le jeu parlementaire. Ce qui caractérise le socialisme réformiste c’est d’une part, d’être devenu un des tenants de la démocratie libérale et d’autre part, de ne plus avoir pour projet politique de supprimer les classes sociales.
Dans la plupart des pays hors de l’Europe, le socialisme n’a pas pris ce tournant réformiste, et porte encore des valeurs qui entrent en lutte contre le libéralisme économique et le capitalisme. Le socialisme évoqué par Clementine et Jay est de cet ordre là, car iels sont canadien·nes.
Introduction
Toute personne qui critique la cancel culture* trouvera cette question familière : et qu’est-ce qu’on devrait faire à la place ? On prétend souvent que celles et ceux qui critiquent la cancel culture en démontrant que le harcèlement, la mise au ban et la présomption de culpabilité n’apportent ni justice ni sécurité, disent dans le fond qu’on ne devrait rien faire dans les situations de violences interpersonnelles. Critiquer la cancel culture est souvent présenté comme une position anti-survivant·es. Et c’est frustrant parce que la réalité c’est que la cancel culture n’est pas un outil efficace pour intervenir dans les situations de violence, et qu’elle produit elle-même encore plus de survivant·es d’agressions et de traumatismes, vu qu’elle expose des personnes, qui ne peuvent ni se défendre ni y échapper, à des campagnes de harcèlement et d’ostracisation.
Notre podcast, Fucking Cancelled, est un podcast socialiste* qui critique et analyse ce qu’on a appelé le Nexus : l’articulation des réseaux sociaux, de l’identitarisme* de gauche et de la cancel culture. On débat de ce qui ne va pas dans la gauche avec l’objectif de rebâtir une gauche solide, ancrée dans la solidarité et la compassion. Nous voulons une gauche qui prend soin des gens et qui fait les choses pour de vrai. Fucking Cancelled est critique des réflexes dogmatiques et punitifs qui sont communs dans la sphère culturelle (plus ou moins) de gauche dans laquelle on évolue en tant que gauchistes queers et anarchistes vivant dans une grande ville. C’est un podcast qui cherche à analyser ces dynamiques et à y proposer des alternatives. L’ensemble de ces réflexes punitifs est communément appelé cancel culture : une norme sous-culturelle très répandue dans laquelle des individu·es peuvent être pris·es pour cibles par de grands groupes de personnes et faire l’objet de représailles pour une offense, réelle ou ressentie, ayant bien souvent à voir avec des questions identitaires. Les observateur·ices extérieur·es à ces milieux ne connaissent souvent que les cancellations de personnes riches et célèbres, mais l’écrasante majorité des cancellations touchent des personnes ordinaires. Ces personnes ordinaires peuvent se retrouver à subir des mouvements d’intimidation en groupe, de plus en plus agressives, dans lesquelles un grand nombre de personnes les harcèlent, les calomnient, révèlent leur vie privée, les ostracisent, tentent de compromettre leur emploi et leur logement, et demandent à leurs ami·es, associé·es, et amant·es de se joindre à cette campagne de harcèlement, au risque de devenir à leur tour la cible de ces attaques. Tout ça est habituellement justifié en utilisant du vocabulaire lié à l’idée de « rendre des comptes, » « répondre de ses actes, » ou encore « prendre ses responsabilités. »
Depuis qu’on a commencé ce podcast et qu’on s’exprime publiquement pour critiquer cette manière de se comporter les un·es avec les autres, on nous a souvent demandé quelles alternatives on avait à proposer. Si on ne peut pas se servir de la cancel culture pour se fliquer les un·es les autres, comment peut-on se préserver, nous et nos communautés, des personnes qui agissent mal ? La réponse instinctive de celleux d’entre nous qui s’opposent à ce genre de chose – dire que la cancelletion n’assure pas, ou pas vraiment, la sécurité des survivant·es et qu’elle épargne souvent un certain nombre de personnes qui agissent mal – n’est souvent pas suffisante pour les gens. Et ça se comprend : les gens veulent des modèles alternatifs. Beaucoup de personnes ont conscience d’une manière ou d’une autre que les processus qu’elles voient déchirer leurs groupes d’ami·es, leurs milieux militants et leurs organisations politiques sont dangereux et nocifs. Mais elles n’ont pas envie de se détacher des normes sociales établies de leurs communautés à moins que quelque chose de mieux ne leur soit proposé, quelque chose qui ait plus de sens.
Il existe d’autres modèles d’intervention en cas de violence, qui n’ont pas recours à la police, mais beaucoup d’entre eux reposent implicitement ou explicitement sur la menace d’ostracisation en dernier recours. Il y a souvent une absence de distinction entre conflit interpersonnel et violence dans ces modèles, ce qui peut mener à une réaction inappropriée ou disproportionnée du collectif. Dans les pages suivantes, on va dire ce qu’on en pense. On est deux alcooliques sobres qui ont une longue expérience des Programmes en 12 Étapes*. On a fait amende honorable* et pris nos responsabilités pour les situations où on n’a pas agi de manière intègre, et on a aidé d’autres personnes à faire la même chose. On a de l’expérience dans l’intervention, la désescalade et le fait de mettre fin à des situations violentes, sans flics, et sans que personne ne se fasse cancel.
Ce zine est une transcription revue et corrigée de l’épisode 6 de Fucking Cancelled. L’épisode, titré « Refuser de rendre des comptes : responsabilité, limites, intervention et punition, » est une analyse de la violence, du conflit et une exploration de quelques alternatives concrètes à la cancel culture et à la culture de « rendre des comptes, » basées sur nos convictions anarchistes et socialistes et nos propres expériences transformatrices dans les Programmes en 12 Étapes.
Vu que c’est la transcription d’une conversation, il n’y a pas de chapitres ou de découpage, mais le sommaire en début de zine signale où on parle de certaines idées importantes pour s’y retrouver un peu plus facilement. On a fait ce zine pour que les gens puissent avoir physiquement nos idées sous la main, mais comme toujours, l’épisode est disponible là où tu écoutes des podcasts, et la transcription non-corrigée est trouvable gratuitement sur notre Patreon. On espère que cette ressource offrira un point de départ pour des réflexions personnelles et des discussions collectives autour de comment naviguer dans les conflits et intervenir en cas de violence sans s’appuyer ni sur les flics ni sur la cancel culture. Un autre monde est possible et on le fait exister par la manière dont on se traite les un·es les autres.
En solidarité, Jay & Clementine.
Bienvenue dans Fucking Cancelled, un podcast qui parle de la Gauche, de ce à quoi elle ressemble, de ce qu’on en fait, et de ce à quoi elle ressemblera une fois qu’on aura fait ça. Dans l’épisode d’aujourd’hui, on va décortiquer les termes « faire du mal » et « rendre des comptes », deux concepts qui sont utilisés régulièrement – et rarement définis.
Clementine- Bienvenue dans un nouvel épisode de Fucking Cancelled.
Jay- Bienvenue ! On a beaucoup réfléchi au fait que l’unique objectif de la cancel culture, ouvertement en tout cas, est d’identifier des situations de « violence » puis d’y répondre d’une certaine manière. Il y a souvent un énorme manque de discernement concernant la signification du terme « faire du mal » et celle d’autres termes qu’on voit un peu partout dans le Nexus1 comme « abus » et « gaslighting », ou encore le terme « rendre des comptes », qui est un peu incontournable quand des personnes discutent des réactions qu’il devrait y avoir à la violence.
Clementine- Au départ dans cet épisode, je voulais décortiquer un schéma que j’ai fabriqué qui sépare quatre aspects de ce qui est regroupé sous le terme « rendre des comptes », pour qu’on soit plus au clair avec ce que les gens font réellement lorsqu’ils font appel à l’idée de « rendre des comptes » et à quel point c’est efficace ou pas selon les situations. Mais quand Jay et moi on a commencé à parler de ça, quand je regardais ce texte que j’avais écrit dans mon zine Fuck the Police Means We Don’t Act Like Cops to Each Other I – j’ai appelé le texte « quatre réactions possibles quand du mal a été fait » – on est tombé·es dans un puits sans fond. L’idée de « faire du mal » est comme l’idée de « rendre des comptes » dans le sens où les gens l’utilisent d’une manière incroyablement vague et nébuleuse. Des personnes peuvent être accusées de « faire du mal » comme seul motif d’accusation, et je trouve que c’est incroyablement vague et pas super aidant. Alors on a commencé à réfléchir à comment on pouvait décortiquer tout ça et trouver un peu plus de clarté avec ce terme là. Cet épisode est notre tentative de faire la lumière sur ces termes. Pour être honnête, on n’est pas loin de rejeter complètement ces termes, parce qu’ils sont devenus si vagues qu’ils ne sont plus très utiles. On va proposer d’autres façons de nommer les idées que ces mots essayent de décrire.
Jay- Oui, je pense que nous ne sommes pas les seul·es à avoir remarqué que ces deux mots étaient utilisés très souvent et à se dire : « Ok, mais qu’est ce que ça veut dire ? Genre littéralement, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? ». Souvent j’essaye d’intellectualiser et de comprendre les choses en écrivant un petit essai sur le sujet, alors c’est ce que j’ai fait. Je me suis principalement concentré·e sur le concept de « faire du mal ». Faire du mal ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Ça peut vouloir dire qu’une personne a effectivement été blessée ou brutalisée d’une certaine manière, mais aussi qu’une personne se sent blessée ou brutalisée. Ça peut faire référence à des choses très graves comme les violences sur les enfants par exemple, et à l’inverse ça peut se référer à quand une personne dit qu’elle se sent blessée à cause d’une blague de mauvais goût.
Clementine- Ou un post sur Twitter qu’elle n’a pas aimé, un truc dans ce genre là.
Jay- Exactement. Donc je me suis dit, qu’est ce que toutes ces choses ont en commun ? Ce sont toutes des situations de conflit. Ou peut être que « conflit » n’est pas le meilleur mot, parce qu’on peut juxtaposer « conflit » et « agression »2. Alors j’ai pensé qu’on pourrait peut être utiliser le terme « discorde ». En gros, je parle des situations où une personne se sent blessée ou a été blessée. Ensuite je me suis dit, maintenant qu’on a défini ce cadre, comment est-ce qu’on peut commencer à sous-diviser ces situations et à les classer pour savoir vraiment de quoi on parle ? Et direct, quand j’en parlais avec Clementine, un truc qui est ressorti c’est qu’il y a cette grande ligne qui sépare différents types de situations où une personne se sent blessée –_différentes situations de discorde. Et cette ligne c’est : est-ce qu’une limite a été dépassée ou pas.
Clementine- On va beaucoup parler de limites dans cet épisode, parce que les limites sont le concept autour duquel tout ça est construit. On va mettre en avant deux schémas pour parler de ces idées. Le premier est un schéma que Jay a fabriqué pour décortiquer ce qu’on veut dire par « faire du mal, » on l’appelle brèche versus intégrité. En gros, dans les situations d’intégrité, aucune limite n’a été franchie, et dans les situations de brèche, une limite a été franchie.
Jay- Oui. Dans ce cas, « brèche » est utilisé dans le sens de quelque chose qui est fissuré, quelque chose qui est brisé. De la même manière que le mur d’un château peut être fissuré. Ça fait référence à l’acte de franchir une limite. Et « intégrité » a une double casquette ici, ça signifie à la fois intégrité dans le sens de entier – le mur du château a maintenu son intégrité – et intégrité dans le sens de la responsabilité d’une personne et tout ce qui va avec. Donc dans les situations d’intégrité, quand quelqu’un·e s’est senti·e blessé·e, on parle d’un scénario où les actions d’une personne ont causé un genre de sensation de blessure, mais en réalité aucune limite n’a été franchie. On pourrait penser à des exemples, comme une dispute de bonne foi qu’on pourrait avoir avec un·e ami·e à propos d’un sujet quelconque. Où personne n’a été insulté·e, rien ne s’est passé de manière non consentie, mais on peut en sortir en se sentant blessé·e que notre ami·e ne nous comprenne pas, par exemple.
Clementine- Ou que notre pote ait une opinion différente de la notre. Avoir un désaccord, c’est souvent présenté en soi comme quelque chose qui fait du mal, non_? Mais en fait, quand deux personnes sont en désaccord, les limites de personne ne sont franchies. Voilà un autre exemple, je l’ai donné dans un article que j’ai écrit, et je pense qu’il s’applique ici. Imagine que tu es dans une relation de long terme avec quelqu’un·e, et que tu te rends compte que tu n’es plus à fond dans la relation. Tu ne veux plus continuer à sortir avec cette personne, tu n’as plus ce genre de sentiments pour cette personne. Mais tu ne peux pas rompre parce que tu fuis le conflit et que tu as peur de la blesser. Du coup, ça peut se passer de deux façons.
Dans le scénario A, tu te dis « ok, j’ai tendance à fuir les conflits mais je vais le faire quand même. » Et tu romps avec la personne, avec autant de douceur que tu peux, mais tu mets fin à la relation. Du coup, dans ce scénario, la personne peut vraiment être blessée, et peut même se raconter que tu lui as fait du mal. On en a vu de ce genre de situation, quand il y a des ruptures et que les personnes se sentent très très fort blessés. Elles ressentent même qu’on leur a fait quelque chose de mal. Mais cette personne a en fait agi en intégrité en étant honnête à propos de ses propres limites en posant que « ce n’est plus le genre de relation que je veux avoir avec toi. »
Alors que dans le scénario B, dans la même situation, la personne est en mode « je ne veux pas blesser ma·mon partenaire, je suis quelqu’un qui fuit le conflit. Alors je vais plutôt être à moitié malhonnête et dépasser mes propres limites et genre continuer à avoir cette relation tout en me coupant de mes émotions. » C’est la stratégie de fuite des conflits, mais en réalité, en faisant ça, ce qu’on fait en quelque sorte, c’est franchir les limites de l’autre personne, parce que cette personne a signé pour une relation consentie et réciproque avec quelqu’un·e qui veut être avec elle. Alors même si tu ne blesses pas cette personne ouvertement en rompant avec elle, d’une certaine manière tu la blesses encore plus parce que tu l’empêches de chercher une relation avec quelqu’un·e qui veut ce genre de relation avec elle. Donc, en fait, être honnête et communiquer, souvent ça peut créer des conflits, ça peut blesser les sentiments des autres – mais c’est toujours dans le domaine de l’intégrité et pas de la brèche.
Jay- Oui. Et pour être clair·es, ici à Fucking Cancelled c’est pas notre truc de mettre la honte aux gens. Je pense que ce genre de situation arrive souvent. C’est pas la fin du monde si un truc comme ça vous est déjà arrivé, ou si vous avez déjà été impliqué·es dans ce genre de trucs.
Donc, dans une situation d’intégrité – disons que c’est toi qu’on accuse d’avoir fait du mal, ou qu’on te suspecte d’avoir été violent·e. Si tu examines ça sincèrement, que tu en déduis que personne n’a eu ses limites dépassées et que tu agis en préservant mon intégrité, alors la manière dont je l’ai analysé dans mon petit essai c’est que ta responsabilité est plutôt passive, ou présumée. Tu n’as pas à aller faire quelque chose pour être responsable, parce que tu te rends responsable en agissant en toute intégrité. Maintenant à l’inverse, il y a des situations de brèche. C’est, je le rappelle, quand les limites d’une personne ont été dépassées d’une manière ou d’une autre. Et dans ces cas là, je pense que c’est beaucoup plus clair qu’il y a au moins une des deux parties impliquées qui devrait se montrer responsable de manière plus active. Souvent, ça serait approprié de sa part de faire amende* d’une manière ou d’une autre. Mais encore une fois, c’est un truc compliqué parce que les limites c’est un truc compliqué. Et il y a beaucoup de sortes différentes de limites, non_? On va parler de ces différentes formes plus tard.
Clementine- Oui. En gros, l’intégrité c’est quand tu agis en accord avec tes propres principes et valeurs et que tu ne franchis pas les limites de quelqu’un d’autre. La brèche c’est une situation dans laquelle tu as franchi les limites de quelqu’un. Et aussi, pour être clair·e, comme disait Jay tout à l’heure, on ne dit pas que ces situations sont toutes horribles, que c’est la fin du monde, que tu es un·e horrible monstre si tu as fait ça. Être humain·es, ça veut dire qu’on va probablement dépasser les limites des autres de temps en temps, de manière anodine, et parfois plus sérieuse. Le but est évidement de ne pas faire ça, mais ce sont des choses qui font aussi partie des relations humaines.
Jay- Tout à fait. Juste pour ajouter vite fait : il y a des situations où les gens agissent totalement en intégrité, et où quelqu’un·e se sent quand même profondément blessé·e. Et il y a des situations où les limites de quelqu’un·e ont été clairement dépassées, mais ça a des conséquences moins importantes et personne ne se sent blessé·e.
Clementine- Complètement. Pour se pencher sur ce que sont les limites, une des premières choses que Jay a mise en évidence c’est qu’il y a des limites implicites qui sont plutôt évidentes et puis des limites explicites qui ont besoin d’être dites. Une limite implicite c’est une limite qu’on peut supposer que tout le monde a, on fait notre vie sans y penser, en partant du principe que ces limites sont là et qu’on ne les franchit pas.
Jay- Et ces limites implicites sont similaires à des droits.
Clementine- Oui c’est le genre de mots qu’on peut mettre dessus. Par exemple : ne mets pas une baffe à quelqu’un·e. À moins qu’on te l’ait demandé [rires]. Tu vois ce que je veux dire. On devrait partir du principe que c’est un comportement inapproprié dans n’importe quelle circonstance. C’est une sorte d’intégrité physique. C’est des limites implicites que tout le monde a, à moins qu’il n’y ait un contexte exceptionnel, comme celui auquel j’ai fait allusion – où on consent à quelque chose comme « j’aimerais que ces limites soient franchies. » Mais on devrait partir du principe qu’on n’agresse pas les gens, qu’on ne les enferme pas dans une pièce : l’intégrité physique est une limite implicite. Il y a plein d’autres choses qu’on met dans la catégorie des limites implicites. Malheureusement dans l’horrible et cauchemardesque culture capitaliste dans laquelle on vit, ces limites sont écrasées tout le temps : le fait qu’une personne ait accès à ce dont elle a besoin à la fois pour survivre mais aussi pour vivre une vie humaine est une limite implicite. On pense ça en tant que socialistes*. Ça veut dire que quand une personne se voit refuser l’accès à un logement, sa limite humaine d’avoir besoin d’un endroit où vivre est violée par le capitalisme, et par un gouvernement qui n’assure pas de logement aux gens. Il y a aussi la nourriture, les soins, des besoins humains fondamentaux comme ça. Et on mettrait aussi là-dedans des choses comme une communauté* et le droit d’avoir des relations humaines et la capacité d’agir dans nos propres intérêts et d’aller vers nos buts. Je crois que beaucoup de gens ne partent pas du principe que ce sont des droits, des choses que les gens méritent tout simplement. Mais nous on croit, fondamentalement, que ce ne sont pas des choses qu’on devrait avoir à gagner. Ce sont des choses qui ne devraient jamais être retirées aux gens. On va développer ça un peu plus – mais il y a très, très peu de circonstances dans lesquelles on pense qu’il est approprié de dépasser ces limites implicites auxquelles chaque être humain·e a droit.
Quand on parlait de ça, on est parti·es dans cette grosse discussion – que sont les limites implicites ? Et comment on peut savoir ce que sont des limites implicites, au delà des trucs évidents du style ne pas mettre une baffe à quelqu’un·e ? Une partie de la réponse serait juste ce qu’on appelle la « considération » : traiter les autres comme on aimerait être traité. Traiter les gens avec de la décence et de la gentillesse humaines basiques, du mieux qu’on peut, au quotidien.
Jay- C’est ça. Et la question qui vient c’est : est-ce que c’est un droit d’être traité·e avec considération par les autres ? Et honnêtement, c’est délicat pour beaucoup de raisons. Et une de ces raisons c’est qu’être traité·e avec considération ça ressemble à quelque chose de différent selon les personnes, et aussi selon les cultures. C’est pas toujours clair. Donc, je sais pas. Je me suis dit, wow tout s’articule autour de qu’est-ce qui est une limite valable ? qu’est-ce qui est un droit ? et qu’est-ce qu’on peut raisonnablement attendre des autres ?
Clementine- Je dirais que c’est une limite valable d’être traité·e avec considération par tout le monde. Je crois pas que ce soit la question. Je crois que la question c’est : comment on définit la considération ? Parce que le problème c’est que tout le monde n’a pas le même ressenti sur ce que ça signifie d’agir avec considération. Comme tu as dit, il y a aussi des différences culturelles et des différences d’une personne à l’autre. Et c’est là qu’interviennent les limites explicites. Parce que, autant on peut présupposer que c’est pas cool de mettre des baffes aux gens, mais par contre on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble précisément de traiter quelqu’un·e d’autre avec considération. À moins qu’on en ait discuté. C’est comme ça que plein de problèmes de communication et de conflits arrivent : parce qu’on fait des suppositions. Même l’affirmation « traite les autres comme tu aimerais être traité » suppose que les autres veulent être traité·es comme toi tu voudrais être traité·e. Ça donne plein de problèmes dans les relations et de dramas, parce que les gens essaient d’être attentionnés sur la base de comment ils voudraient être traités, mais en fait c’est pas pareil pour l’autre personne. L’autre personne supposait peut-être que c’était une limite implicite facile à comprendre.
Du coup, c’est une bonne idée d’avoir ces conversations. Ça peut avoir l’air bizarre d’expliquer dans le détail les bases de comment on aimerait être traité·e à nos potes ou aux gens avec qui on sort ou à nos communautés, mais ça peut vraiment aider pour apaiser les conflits et aussi pour se rendre compte de si nos limites sont compatibles, ce dont on va parler plus tard. Par exemple, il y a des gens qui partent du principe que quand on commence à sortir avec quelqu’un·e, on s’envoie des textos tous les jours. Et ces personnes se sentiront blessées si ça n’arrive pas, parce qu’elles supposent que c’est une évidence. Mais l’autre personne peut n’avoir aucune idée qu’on pense que c’est une évidence, et ça peut être quelque chose avec quoi elle n’est pas à l’aise comme attente. Et parce que personne n’en a parlé et qu’il n’y a eu ni compromis, ni décision à propos de ça, ça se transforme en confusion et en sentiments blessés.
Jay- Oui. Genre, je connais des personnes pour qui la non-monogamie est une norme, et si une personne avec qui iels commencent une relation veut être monogame il faut que ça soit négocié. Alors que d’autres personnes diraient que quand elles commencent à sortir avec quelqu’un c’est plutôt la monogamie qui est la norme.
Clementine- Vraiment, tu crois ?
Jay- Je pense que la plupart des gens pense ça. Genre au moins si tu commences à sortir avec quelqu’un·e sérieusement.
Clementine- Oui dans ce cas ok. Mais c’est perturbant… Bon, grande révélation, on est polyamoureux·ses, on parle des personnes monogames et on essaye de comprendre ce qui peut bien se passer dans leur tête [rires]. Mais de ce que je comprends de la culture de drague actuelle chez les personnes monogames, il y a une période normale de non-monogamie, pendant laquelle c’est acceptable de voir plusieurs personnes jusqu’à ce que ça devienne « sérieux » avec une personne. Mais ce que ça signifie, quand est-ce que ça devient « sérieux », n’est pas clairement défini ou compris de la même façon par tout le monde. Donc, si on n’en parle pas, on peut se retrouver à se sentir blessé·e hyper fort quand une personne présume qu’on en est au stade de la monogamie et que l’autre pense que c’est pas encore sérieux et voit d’autres personnes. Ce genre de problème de communication peut arriver tout le temps dans plein de contextes différents. Ça peut être aussi simple que… Une personne pourrait être vraiment offensée que tu ne dise pas « à tes souhaits » après qu’elle ait éternué. Elle pourrait trouver ça malpoli ou quoi. Alors que quelqu’un d’autre se dirait « quoi ? J’aurais jamais imaginé un truc pareil. » La manière dont on interprète le comportement dépend vraiment du contexte, de la personne et de comment elle a grandi.
Jay- Oui, ou un truc culturel comme ne pas retirer ses chaussures à l’intérieur de la maison, ça pourrait être vraiment, vraiment grossier pour quelqu’un d’une culture particulière. Alors que ça serait normal dans plusieurs parties des États-Unis.
Clementine- Exactement. Du coup, pour faire simple, parlez de tout ça ! Ça aide à comprendre ce qu’est une brèche. Parce que si une limite nous a été communiquée explicitement et qu’on l’approuve, et qu’ensuite on franchit cette limite, c’est une brèche. Et si on franchit ce qui est communément reconnu comme une limite implicite, comme violer l’intégrité physique d’une personne, c’est aussi une brèche.
Jay- C’est ça. Mais toutes les brèches ne sont pas les mêmes. Et donc j’ai pensé à d’autres subdivisions à l’intérieur des brèches pour étoffer cette catégorisation. Les principales sont : est-ce que le comportement en question est continu ou ponctuel, genre est-ce que ça ne s’est produit qu’une fois ou pas ; est-ce que c’est grave ou pas dans ses conséquences ; est-ce que c’est intentionnel ou non-intentionnel ; et aussi est-ce que c’est possible d’y échapper ou pas – en gros est-ce que la personne qui est soumise à ce comportement peut facilement partir ou y mettre un terme, ou au contraire, est prise au piège ou impuissante. Donc, dans les situations où le comportement en question est continu, où ses conséquences sont graves, où il est intentionnel, et où une personne est incapable de s’enfuir, ce sont les caractéristiques de scénarios d’abus grave, n’est-ce pas ? Alors qu’un comportement qui ne se produit qu’une fois, qui a des conséquences relativement légères, qui n’était pas fait exprès, et sera très facile à éviter à l’avenir – là, tout ce qu’on a à faire c’est de s’excuser. C’est comme marcher sur le pied de quelqu’un, ou, je sais pas, mal prononcer le nom de quelqu’un, quelque chose comme ça.
Clementine- Et tout ça fait partie d’avoir des relations. Être humain·e, ça veut dire qu’on va probablement faire des brèches de temps à autre. On va dépasser les limites des autres, de manière anodine, sans en avoir l’intention, et c’est ok. On peut réparer ça rapidement et aller de l’avant. Mais ce qu’on constate souvent c’est que toutes ces choses – autant des actes intègres que différentes sortes de brèches, allant des très bénignes aux très graves – sont souvent toutes mises dans le même sac de « violence » dans la cancel culture. On peut voir des exemples de gens qui postent leurs opinions politiques sur Twitter et des personnes les accuser d’être violentes parce qu’elles font ça. Elles diront que ça fait du mal. Et puis on a aussi des situations où quelqu’un·e est accusé·e de faire subir des violences domestiques graves et ça aussi ça sera nommé faire du mal.
Et c’est un gros problème, parce que de dire uniquement « faire du mal » – j’ai remarqué que ça arrive vraiment de plus en plus souvent que les accusations soient juste : « cette personne est accusé·e d’avoir fait du mal. » J’ai été témoin de ça. Ça ne nous dit littéralement rien sur ce dont cette personne a été accusée, mais ça justifie cette énorme réaction que les gens appellent « demander de rendre des comptes », qui est souvent une campagne d’ostracisation. Du coup c’est vraiment difficile de s’assurer que la réaction est proportionnée à ce qui s’est passé et/ou qu’elle est efficace, c’est même difficile de savoir si c’est judicieux de réagir de cette manière là. Parce que dans une situation d’intégrité, où une personne ne franchit pas de limite, ce n’est vraiment pas judicieux de réagir de manière autoritaire et agressive, en franchissant les limites de cette personne. Ça marche de la contredire, c’est ok de dire « je ne suis pas d’accord. » Tu peux écrire ton propre post, écrire « je ne suis pas d’accord. » Mais évidemment, c’est pas ça qui se passe dans la cancel culture, et on voit des personnes se faire harceler et traverser des trucs punitifs super intenses basés sur la rhétorique de « faire du mal » et de « rendre des comptes. »
Voilà, on présente tout ça juste comme un cadre de réflexion, ce n’est pas nécessairement la seule manière de réfléchir à tout ça.
Jay- Oui, j’ai trouvé ce truc il y a 2 nuits, alors même si ça se base sur des choses auxquelles on a beaucoup réfléchi, je ne dis pas que vous devez le considérer comme la seule référence en matière de philosophie des conflits.
Clementine- Ce qui nous tient à cœur c’est d’inviter nos auditeur·ices à décortiquer ces mots. Utilisez ce cadre de pensée s’il vous aide à faire ça. Réfléchissez à ce qu’il soulève, regardez là où il est limité et quelles autres questions il soulève pour vous. Si vous avez d’autres manières de réfléchir à ce sujet, cool ! On vous invite à écrire dessus, à en parler.
Jay- Oui, on vous encourage à vous pencher sur le sujet et à essayer de distinguer les différentes situations dans lesquels des personnes affirment que quelqu’un·e a fait du mal. Parce qu’il faut qu’on soit capable de faire ça en tant que créatures sociales. La violence, ou les conflits, ou les sentiments blessés, différents types de discorde se produisent littéralement constamment dans une société. Ça fait partie de ce qui fait qu’une société est une société. C’est impossible à éviter totalement. Et aussi, je dirais qu’en tant que personnes intéressées par l’anarchisme – même si vous n’êtes pas des anarchistes purs et durs, beaucoup de personnes sont intéressées par l’anarchisme d’un point de vue philosophique par exemple – je pense que quand on l’est en tout cas, on doit vraiment se pencher là dessus, parce qu’en fin de compte on essaye de penser à quoi pourrait ressembler une société future qui ne serait pas une société dominée par le système carcéral et les hiérarchies.
Clementine- Bon, on se rend vite compte qu’on est anarchistes dans nos manières de formuler les choses. On a à peine parlé de capitalisme, mais c’est très vrai que ces systèmes de pouvoir étendus, comme l’état et le capitalisme, violent les limites des gens tout le temps. C’est le contexte dans lequel on vit. Et on met en avant des cadres pour penser les problèmes de relations interpersonnelles ou les moments où on dépasse les limites les un·es des autres. Mais on part du principe que, évidemment, il y a ce contexte plus vaste dans lequel nos limites sont écrasées par le capitalisme.
Jay- Oui. J’aimerais aussi pointer encore une fois qu’en apparence la cancel culture est censée être une manière de gérer les conflits interpersonnels sans passer par l’état. Soi-disant, hein. Et comme ça ne marche clairement pas, on devrait la décortiquer et essayer de démêler ce qui s’y passe vraiment. Voilà, c’est ça notre petit cadre pour essayer de décortiquer ce que « faire du mal » signifie.
Et maintenant pour avancer, Clementine a trouvé une manière de décortiquer ce qui est souvent amalgamé sous ce terme de « rendre des comptes » mais qui est rarement tiré au clair. Les gens utilisent souvent les mots « rendre des comptes » sans jamais vraiment dire ce que ça signifie pour eux : quels sont les objectifs, ou alors – et je pense que c’est plus important, quelle est l’espèce d’impulsion sous-jacente. Pourquoi est-ce que rendre des comptes est nécessaire et qu’est-ce que vous en attendez ?
Clementine- Oui, pour être honnête je hais vraiment l’expression « rendre des comptes » à ce stade.
Jay- Oui, je ne l’utilise jamais.
Clementine- Je ne m’en sers pas, je la trouve incroyablement vague.
Jay- Elle a tellement été utilisée à tort qu’elle ne veut plus rien dire.
Clementine- Et elle est souvent utilisée pour justifier des comportements ouvertement abusifs.
Jay- Oui grave. En plus ça me fait penser à des comptables et des entreprises.
Clementine- Oui, je ne crois pas que ça soit une expression très utile. C’est clivant ce que je dis là, mais je ne crois pas que c’est un mot utile. Je crois qu’il masque ce qu’on essaye vraiment de faire. Du coup, je voudrais complètement le déconstruire, parce que je suis là, visible, à écrire sur la cancel culture, à parler de la cancel culture, et puis je me prends beaucoup de rejet tout le temps –ouais, c’est littéralement ça ma vie. Surtout quand j’avais mes commentaires activés sur Instagram, mon dieu – les gens étaient en mode « OK mais alors qu’est-ce qu’on fait de ci ou ça ? » Et toutes ces choses qu’ils considéraient faire partie du processus de rendre des comptes, mais en fait c’est autre chose. Je me dis que non seulement on peut atteindre ces buts sans cancel les gens, mais aussi que cancel les gens, ça nous empêche en réalité d’atteindre ces buts. Et c’est un gros problème. Ça me dérange beaucoup que des gens accusent celleux d’entre nous qui rejettent la cancel culture d’en avoir rien à foutre des violences, ou d’en avoir rien à foutre des gens qui ont des comportements qui violent vraiment les limites des autres. J’en ai vraiment quelque chose à foutre en tant que survivant·e. On va en parler plus tard, mais autant Jay que moi on a fait l’expérience de prendre la responsabilité de nos comportements qui ont dépassé les limites d’autres personnes, de la merde qu’on a fait. Parce qu’on est des addict·es et qu’on a fait l’expérience des programmes en 12 étapes*. On a aussi l’expérience d’intervenir et de mettre activement fin à des violences. Alors j’ai vraiment des tonnes de trucs à dire à propos de ça, et j’y crois énormément. Je pense que c’est super important, je veux que les gens aient accès à ces savoirs et ces compétences. C’est juste que la cancel culture ne sert littéralement pas à ça. On continue juste à faire semblant qu’elle le fait.
Du coup, je veux déconstruire quelques réactions possibles à des situations de brèche ou même d’intégrité, mais dans lesquelles l’intégrité de la personne ne marche juste pas pour nous. Parce que des fois, il y a des situations de brèche où nos limites ont été franchies et c’est genre, ok, qu’est-ce qu’on fait ? Ou les limites de quelqu’un·e à côté de nous ou de quelqu’un·e qu’on connaît ont été franchies – qu’est-ce qu’on fait ? Mais il y a aussi des situations où c’est plutôt : ok, mes limites n’ont pas été franchies, mais je suis vraiment vénèr et je suis vraiment blessé·e. Ce que fait cette personne me met vraiment en colère, même si mes limites n’ont pas été franchies. Et donc « faire rendre des comptes », comme on dit couramment, tente de répondre à toutes ces situations différentes. Et on appelle toutes ces différentes situations « faire du mal. »
Et parlons donc de ce qu’on pourrait faire à la place de la cancel culture, de ce qui serait plus efficace et plus adapté aux situations réelles. Il y a principalement trois éléments : la responsabilité, les limites et l’intervention. La première chose dont je veux parler c’est la responsabilité. Je sais qu’on en déjà parlé dans ce podcast, mais je suis à fond sur la responsabilité, je pense que c’est hyper important. Du coup, on a divisé la responsabilité en quelques éléments qui la constituent.
Jay- Ok. Donc le premier élément c’est que, en général dans le monde, on doit être capable de se connaître, de connaître nos propres limites, de connaître nos propres valeurs et principes, et d’agir en accord avec.
Clementine- Oui, ça c’est vraiment la base. Comment peut-on être responsable de nous-mêmes si on ne sait même pas ce que sont nos besoins, nos limites, et aussi nos valeurs et nos principes ? On a besoin d’un cadre à partir duquel on pourra agir. Une façon d’agir de manière responsable dans le monde est de savoir ce dont on a besoin, ce qu’on n’accepte pas, et quels sont nos principes.
Jay- Grave. Nous sommes responsables de savoir quelles sont nos foutues limites.
Clementine- Oui, c’est quelque chose de super important parce que quand on parle de « brèche, » il y a cette idée de limites implicites ou explicites. Et un paquet de gens fonctionnent plus ou moins de cette manière : ils se disent « ben, mes limites sont évidentes. Et si quelqu’un franchit mes limites, c’est de sa faute. Cette personne a fait du mal. » Mais as-tu exprimé ta limite ? Bien sûr, ne pas frapper quelqu’un·e est une limite évidente. Tu n’as pas besoin de débarquer et de dire, « salut, j’ai une limite avec le fait qu’on me frappe au visage. » Évidement. Mais d’autres choses ne sont pas aussi évidentes et il y a besoin de les dire. Et pas seulement les dire, mais aussi les négocier dans tes différentes relations. Parce que les autres personnes ont elles aussi des limites, et vos limites respectives peuvent ne pas correspondre les unes avec les autres.
Jay- Oui, et travailler sur les limites c’est très, très difficile. Certaines personnes y arrivent plus facilement que d’autres, c’est sûr. Et les traumatismes peuvent participer à ce qu’on trouve ça vraiment difficile. Mais aussi, si on est globalement du genre à éviter les conflits, ça peut rendre ça vraiment difficile. Avoir des parties de soi qu’on n’aime pas regarder peut rendre ça assez difficile aussi. Et en vrai… connaître parfaitement toutes ses limites ça prend des années de travail, souvent beaucoup de thérapie, etc. Alors, encore une fois, on ne veut pas mettre la honte à des gens, si par exemple vous avez été dans une situation où vous avez compris quelle était votre limite après les faits ou quoi, c’est totalement normal. Moi-même j’ai du mal à poser mes limites à certains moments. Et c’est aussi fréquent quand on a beaucoup dépassé nos limites, ça peut rendre encore plus difficile de les poser parce qu’on se dit « et si les gens les piétinaient juste ? Ça serait peut être mieux que je ne les pose pas et comme ça je peux essayer de contrôler la situation d’une autre manière. »
Clementine- Complètement, on va aller plus loin avec les limites dans la prochaine partie et parler de ça plus en détail. Mais ouais, je pense que ce que dit Jay est très très important.
Jay- Ce dont on va parler ensuite c’est des comportements à avoir dans l’idéal, ok ? Ça ne veut pas dire que tout le monde sera balèze dans ce domaine tout le temps hein !
Clementine- C’est sûr ! On vous encourage à ne pas avoir honte et à ne pas avoir l’impression d’être une merde si vous n’avez pas su être à la hauteur de votre idéal de responsabilité.
Jay- On ne pense pas que c’est quelque chose qui doit s’apprendre dans la souffrance. On pense que tout le monde devrait s’entraider tout le temps avec ces choses là et plus on sera tou·te·s éduqué·es là-dessus, mieux on y arrivera.
Clementine- Carrément, il se trouve justement que Jay et moi on a beaucoup d’expérience dans tous ces trucs avec les vies de ouf qu’on a eues, et on est là pour essayer de parler de tout ça et pour partager ce savoir avec les gens. Du coup, connaître nos propres limites c’est pas une partie de plaisir, mais se montrer responsable, c’est en partie travailler à les connaître.
Un autre aspect de la responsabilité c’est de respecter les limites des autres et d’être de bonne foi dans nos actions. Il y a les limites implicites dont on a parlé. On devrait partir du principe qu’elles sont là. On devrait aussi avoir de la curiosité pour les limites des autres. On ne peut pas lire dans les pensées : on ne peut pas savoir quelles sont les limites d’une personne. Ça devrait être une pratique courante dans nos relations, de parler de ces trucs et de le demander aux autres. Et puis, il y a le contexte du sexe et du consentement, où la question de base c’est : « Hé, est-ce qu’il y a des trucs que t’aimes pas du tout ou qui sont une limite absolue pour toi ? » C’est une question de base de sexe/consentement, mais c’est aussi une question qu’on peut étendre à comment les personnes ont envie d’être traitées en général dans leurs relations. En particulier quand on construit une nouvelle relation avec quelqu’un·e, spécifiquement dans les relations romantiques, on présuppose des tonnes de trucs qu’on ne dit pas, à propos de la manière dont la relation va fonctionner. Du coup c’est vraiment important d’avoir des discussions ouvertes plutôt que de faire des suppositions et d’espérer qu’on est sur la même longueur d’onde. Quand les gens arrivent à exprimer leurs limites, à les poser, pour agir de manière responsable on doit respecter ces limites là. La partie suivante – tu veux dire ce que c’est ?
Jay- Oui. Alors le prochain élément de la responsabilité c’est la responsabilité de réparer, quand les choses ont mal tourné. Et je pense que c’est là où ça se rejoint le plus avec ce que les gens ont tendance à appeler « rendre des comptes. » Si tu as dépassé les limites de quelqu’un·e, c’est une bonne idée que tu essayes de réparer ça d’une manière ou d’une autre. Ça n’est pas toujours possible, mais c’est souhaitable. C’est très important, et c’est aussi très important d’essayer de réparer les choses quand on a agi hors de nos propres limites.
Clementine- Pas seulement hors de nos propres limites mais aussi hors de nos principes. On a de l’expérience avec le fait de réparer nos torts, de faire amende honorable3. Du coup, on aborde tout ça à travers le prisme de faire amende honorable. Des fois c’est vraiment évident qu’on a franchi les limites de quelqu’un·e. Genre : « J’étais déchiré·e et je lui ai hurlé dessus, » ou un truc comme ça. Et on a besoin de réparer nos torts pour ce genre de chose. Mais il y a d’autres moments – et ça c’est venu dans notre discussion aujourd’hui-même – où on repense à une situation et on se dit : « wow, j’ai vraiment pas bien traité cette personne. » Du coup on veut faire amende honorable. On le fait et la personne nous dit : « Oh, pour moi c’est pas grand chose. Ça ne m’a pas blessé·e du tout. Mais merci quand même. » Et dans ce cas, c’est intéressant, parce qu’on n’a pas dépassé les limites de cette personne. Ce qu’on a fait en réalité, c’est agir hors de nos principes ou de nos valeurs.
On peut avoir un principe du genre – je cherche un exemple au hasard, mais disons, que c’est important pour moi de prendre des nouvelles de mes potes régulièrement. C’est un principe que j’ai dans mes relations. Et je n’ai pas pris de nouvelles de ce·tte pote. Peut-être que j’ai passé plusieurs mois sans lui écrire par exemple. Du coup, tu fais amende auprès de cette personne, et elle te dit : « En vrai, dans mes relations, je m’en fous qu’on se parle pas pendant des mois avec mes potes. Je peux parler à quelqu’un·e deux-trois fois dans l’année et quand même me sentir proche de cette personne. » Du coup, la raison pour laquelle tu te sentais mal, c’était pas parce que tu avais franchi les limites de cette personne, car ce n’est pas le cas. En fait c’est parce que tu n’as pas été à la hauteur de tes propres valeurs, ce qui est aussi important. C’est important qu’on ait des valeurs et des principes et d’agir en fonction d’eux du mieux qu’on peut. Et c’est ok de faire amende dans ce cas aussi. Mais c’est plus, comme une amende pour soi-même à ce moment là.
Jay- Tout à fait. Et je pense que beaucoup de personnes qui passent par les étapesII ont des expériences dans ce genre. Par exemple j’avais un espèce de bail avec un mec il y a quelques temps et je l’ai un peu ghosté, alors qu’il était super gentil avec moi et tout. Mais j’étais un·e ivrogne et ma vie était un peu chaotique à cette époque. Et quand j’ai commencé à être sobre et à faire mes étapes, j’ai fini par le recontacter et lui faire des excuses. Et en gros il m’a dit « je vois pas de quoi tu parles. » [rires] Ouais. Donc en gros ça dit plus de choses sur moi que sur lui, et ça me dit surtout qu’une de mes valeurs est de ne pas disparaître de la vie des gens si possible.
Clementine- En gros on veut décortiquer ce que ça veut dire de prendre ses responsabilités quand on a… – sérieux, je suis tellement conditionné·e à dire « fait du mal » que je dois me reprendre volontairement pour ne pas le dire. Parce que c’est super vague. Du coup – quand on a franchi les limites de quelqu’un·e, et qu’on veut réparer les choses. Dans les programmes en 12 étapes, il y a toute une procédure qui nous permet de faire ça. Et ce n’est pas du tout une pratique qui existe dans le Nexus. Ce n’est pas quelque chose qui est pratiqué ni même compris dans ces spectacles où on exige que des comptes soient rendus.
Bon. Expliquons un peu à quoi ça ressemble la responsabilité dans le cadre des 12 étapes. Premièrement – et c’est la chose la plus importante – prendre ses responsabilités ne peut venir que de la volonté de le faire. Ça doit être quelque chose qui est entrepris librement. On ne peut pas forcer quelqu’un·e à prendre ses responsabilités. C’est impossible en fait. Ce n’est pas qu’on ne doit pas forcer quelqu’un·e – enfin, si il ne faut pas faire ça non plus – mais c’est qu’on ne peut pas. Parce que prendre la responsabilité d’avoir blessé d’autres personnes, d’avoir dépassé les limites des gens, d’avoir eu des comportements de merde, ou autre, faire ce genre de travail, c’est profondément transformateur. C’est du travail profond, intense. Et il faut que ce soit bien fait. On ne peut pas passer vite fait dessus. Parce que sinon, on va juste montrer aux gens ce qu’on pense qu’ils veulent, ce qu’ils veulent voir. Mais ce n’est pas réel.
C’est juste, pas une bonne idée. Ça ne fait du bien à aucune personne impliquée dans la situation, parce que la personne ne prend pas vraiment ses responsabilités. Elle n’est pas vraiment en train de transformer les choses, elle n’est pas vraiment en train de faire le travail nécessaire pour guérir des trucs qui lui arrivent, pour avoir le soutien dont elle a besoin pour changer. Elle n’est probablement pas capable de changer son comportement du jour au lendemain, parce qu’elle n’a pas démêlé le bordel qui se passe dans sa vie. Du coup, une des pires choses qu’on puisse faire, c’est de faire amende honorable auprès de quelqu’un·e, puis continuer de se comporter exactement de la même manière. C’est atroce. Du coup, il ne faut pas faire amende si on n’est pas prêt·e, et il ne faut pas faire amende juste parce qu’on nous harcèle sur internet et qu’on nous malmène pour nous forcer à réparer nos torts.
Jay- Ça n’est pas vraiment faire amende dans ce cas. Et puis, un·e adulte responsable c’est une personne autonome, n’est-ce pas? Et l’autonomie ça veut dire qu’on ne te force pas à faire un truc.
Clementine- Exactement. Je pense que ça c’est fondamental.
Jay- Et ce n’est pas une chose sur laquelle on s’attarde dans le Nexus, je veux dire c’est complètement ignoré, voire même on s’y oppose activement.
Clementine- On s’y oppose activement. Par exemple, on entend souvent dire « cette personne refuse de rendre des comptes. »
Jay- Ou alors, « qu’est-ce que je peux faire si cette personne refuse de prendre la responsabilité de ses actes ou refuse de rendre des comptes ? »
Clementine- Il y a des choses qu’on peut faire. Mais on ne peut pas réellement forcer qui que ce soit à prendre ses responsabilités. Ce n’est vraiment pas quelque chose qu’on est capable de faire. Et j’aimerais que les gens comprennent ça. Parce que c’est une chose sur laquelle on n’a pas de pouvoir, on ne peut forcer personne à le faire. Et je ne dis pas que ça craint pas. Ça craint, et ça fait beaucoup souffrir. Honnêtement, je pense très fort aux survivant·es quand iels entendent ce genre de discours – d’autant plus quand je le dis de façon aussi catégorique – à quel point iels se sentent blessé·es et impuissant·es. Parce qu’iels se disent : « Comment la justice pourra m’être rendue alors ? Comment est-ce que je vais bien pouvoir guérir si cette personne n’assume pas ses responsabilités ? » Pour moi c’est un des effets secondaires regrettables de beaucoup de discours sur les survivant·es et la violence qui flottent dans le Nexus, dans lesquels, on sait pas trop comment, on conditionne notre propre guérison au fait que d’autres personnes reconnaissent leurs torts. Ce qui est absurde. Et dangereux pour les survivant·es. Parce que la réalité c’est que, pour beaucoup d’entre nous, on n’aura jamais la reconnaissance qu’on mérite. Et ça ne veut pas dire qu’on ne la mérite pas ; on la mérite absolument. Mais on ne peut pas forcer quelqu’un d’autre à faire ça. Et perso, je suis en rupture totale avec mes parents. Je comprends intensément à quel point c’est douloureux quand tu veux que quelqu’un·e reconnaisse ses torts et que tu l’espères tellement fort, mais qu’iel ne le fait pas. Parfois ça veut dire que tu as besoin de mettre une limite très solide avec cette personne, d’où ma rupture familiale. Du coup, ça craint qu’on ne puisse pas forcer ça, mais en fait, on ne le peut pas. Et c’est juste une réalité.
En partant de là, dans le modèle des programmes en 12 étapes, en gros ce qui se passe c’est que la personne entre dans un processus de guérison et de soin volontairement. La première partie de ce processus n’a en fait rien à voir avec le fait de prendre la responsabilité de ses comportements merdiques. Ce processus commence parce qu’elle souffre énormément et sait qu’il y a des trucs qui vont de travers dans sa vie, et qu’elle a besoin de régler ça. C’est l’envie d’aller mieux qui motive qu’on s’investisse là-dedans. Pas simplement l’envie de « devenir quelqu’un de bien » ou ne plus se sentir coupable. Tu te dis plutôt : « ok, je souffre beaucoup trop et quelque chose doit changer. »
Jay- Oui. Souvent ça vient simplement d’une honte insupportable.
Clementine- Complètement. Dans le programme, on parle de « toucher le fond. » Ou juste d’en être arrivé·e à se dire « putain, tout ça, ça craint et j’ai vraiment besoin de faire quelque chose. Je veux essayer de faire les choses différemment. » À partir de là, ce qui se passe c’est que cette personne est entourée par une communauté. Quand on parle de prendre ses responsabilités, on met l’accent sur le côté individuel dans le sens où il n’y a que l’individu qui puisse être prêt à ça. Personne ne peut faire ça à sa place. Cette volonté doit venir de l’individu. Mais prendre ses responsabilités, c’est pas quelque chose qu’on fait seul·e. C’est quelque chose qu’on fait entouré·e par une communauté qui se soucie sincèrement de nous, qui nous aide, qui prend soin de nous. Dans le programme, tu peux être la personne la plus craignos et problématique de la terre, il y aura tou·te·s ces inconnu·es qui viendront te voir, te serviront du café, et te diront « voilà mon numéro, appelle moi quand tu veux. » On t’y donne une abondance d’amour et de soutien.
Jay- Et il n’y a aucun moment où il y a de la pression, ni aucun mécanisme pour forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit.
Clementine- C’est ça. Et c’est pas conditionnel. C’est pas « on te donne de l’amour et du soutien parce qu’on sait que tu prendras tes responsabilités dans le futur. » Même si tu ne prends jamais tes responsabilités dans le futur, on te donne réellement cet amour et cette communauté de manière inconditionnelle. Ça ne veut pas dire que tu peux te pointer et frapper les gens. On mettra probablement une limite avec toi si tu fais ça. Mais c’est pas parce que tu as fait tous ces trucs fuckés dans ta vie que les gens te retireront la communauté, le soutien et le soin. Encore une fois, c’est l’opposé de ce qu’on voit se passer dans le Nexus et dans la cancel culture. Ce qui se passe si tu as été cancel, c’est qu’on te retire ta communauté.
Jay- Oui. Et c’est important de noter que même si la responsabilité qui se construit à ce moment là existe effectivement au sein d’une communauté, ça n’est pas un spectacle et on n’a pas à énumérer nos crimes devant un groupe de personnes ou un truc du genre. Même si pendant un groupe de parole on peut tout à fait parler des choses qu’on a pu faire.
Clementine- Oui, il y a un moment dans les étapes du programme où tu racontes toute la merde que t’as fait à une personne. Une personne de confiance qui garde ça pour elle et ne le partage avec personne d’autre, c’est une confiance sacrée. Ça fait que t’es juste perçu·e comme pleinement humain·e – avec toute la merde, les trucs dont tu as le plus honte – et tu te rends compte qu’on te traite encore dignement et avec compassion, même avec tout ça. Voilà. Un paquet de gens se disent : « si les autres étaient au courant de mes pires trucs, personne ne m’aimerait. Je n’aurais pas de communauté. » Faire cette expérience-là, ça te montre que c’est pas vrai, que tu peux montrer les pires trucs que tu as fait à quelqu’un·e et que cette personne croira toujours en ton humanité, en ta capacité à évoluer et voudra t’aider à avancer et trouver ton intégrité. Parce qu’elle pense que cette intégrité, c’est aussi toi. Tu n’es pas défini·e par les pires choses que tu aies jamais faites. En fait, ce qui te définit c’est ta volonté d’être là et de faire ce boulot. Ce qui est quelque chose de profondément courageux.
À partir de là, tu regardes en face tout ce bordel, ce qui s’est passé pour toi. Tu regardes ton propre trauma. On t’encourage à aller chercher du soutien extérieur si tu en as besoin, aller voir un·e psy par exemple. Tu te rends compte de pourquoi tu te comportais comme ça, et alors tu commences à travailler pour changer durablement ces comportements et être en accord avec toi-même. Et ce changement continu, c’est une grosse partie de ce que c’est de prendre ses responsabilités. Ensuite tu entames un processus consistant à te demander ce qui s’est passé pour les autres personnes, et ça fait développer une empathie sincère et profonde. Pas une performance d’empathie du genre, « les gens m’engueulent sur internet et je veux qu’ils arrêtent. » En fait tu te demandes, « J’ai crié sur cette personne quand j’étais bourré·e. Comment elle a vécu ça ? Quelle expérience émotionnelle ça a été d’avoir sa·son pote qui lui tombe dessus comme ça et lui dit des trucs atroces ? » C’est un point de départ pour développer ta compassion, ton empathie et comprendre vraiment comment ça a été vécu par l’autre. Et il n’y a qu’à partir de là qu’il peut y avoir un processus de réparation.
Ça peut prendre différentes formes selon la situation. Ça implique toujours d’avoir changé de comportement de manière durable. Ça implique généralement d’aller voir la personne et de faire amende honorable en face à face. On demande son consentement d’abord, pour voir si c’est quelque chose qu’elle a envie de faire, et si c’est le cas on va la voir. On lui dit ce qu’on comprend de ce qui s’est passé et ce qu’on imagine que ça a dû être pour elle. On exprime nos regrets. Et on s’excuse, sincèrement. C’est une expérience qui nous transforme et qui nous change tellement. J’ai fait amende honorable plusieurs fois. J’ai aidé des gens à se préparer à faire ça. J’en ai reçu. Et c’est extrêmement puissant et transformateur. La plupart des gens veulent juste savoir que leur souffrance a de l’importance pour l’autre et que c’est pas juste quelque chose qu’on met de côté, qu’on prend ça au sérieux de les avoir blessé. Et puis des fois, il y a besoin de faire des choses plus concrètes pour réparer la relation, si c’est ça qui est au programme. Rembourser de l’argent qu’on a volé par exemple, des trucs comme ça. C’est à ça que ça ressemble la responsabilité dans le cadre des programmes en 12 étapes.
Jay- On en a déjà parlé dans le podcast, mais ça vaut le coup de répéter : un élément très, très important de tout ça c’est que pendant ce processus on nous donne les outils pour déterminer si oui ou non on doit faire amende auprès de quelqu’un. Il y a beaucoup de personnes qui sont poussées par la honte et qui essayent de faire amende pour des choses dont elles ne devraient pas s’excuser, parce que ça ne serait pas honnête de leur part.
Clementine- On en revient à intégrité versus brèche, non ? Le travail que tu fais avec ton parrain·ta marraine* c’est de passer en revue toutes ces situations dans lesquelles les gens sont pires vénèr contre toi et pensent que t’es une merde. On regarde tout ça et on se pose la question : est-ce que c’était une brèche ou est-ce que j’étais intègre ? C’est important en particulier pour les personnes qui ont tendance à avoir une réponse traumatique de sujétionIII, à vouloir plaire aux autresIV. Moi, je me disais « purée, je deviens sobre. Je guéris. Je suis en train d’aller mieux. Personne ne sera plus jamais en colère contre moi. Je serai capable d’être une bonne personne. Quand je serai désolé·e et plein·e de regrets, les gens me pardonneront. » Mais en vrai, il y a plusieurs situations où les gens pensaient que j’étais une merde, mais où je n’avais rien fait de mal. Je n’avais franchi les limites de personne et j’agissais de manière intègre. C’est dur pour les gens qui veulent plaire aux autresV de se rendre compte de ça. Parce qu’on se dit « sérieux ? Tu me dis que même après tout ça, le gens me détesteront encore ? » Et, ouais. Des fois les gens te détesteront toujours. Et ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal pour autant.
Jay- Et souvent plus on s’améliore pour renforcer nos propres limites, plus il y a de monde qui ne peut pas nous saquer. Parce que les gens galèrent avec les limites des autres tout le temps.
Clementine- Absolument. Plus tu deviens intègre, plus les gens vont être en colère contre ça. Ça s’est toujours passé comme ça pour moi.
Voilà… c’était un aperçu de la responsabilité. C’est une compétence hyper importante. Ça peut aller d’un truc tout simple du genre : « On s’est pris la tête avec ma·mon pote et j’ai pas été respectueux·se. » Et on peut juste læ checker plus tard pour lui dire : « hé, j’ai pas été respectueux·se, c’était pas contre toi. Je suis désolé·e pour ça. » Ou ça peut être quelque chose de plus grave. Genre y a pas longtemps, j’ai fait amende honorable à une personne parce que je l’avais cancel. J’ai un autre exemple dont j’ai parlé dans le podcast, où j’ai raconté que ma·on ex était un·e agresseur·se alors que c’était pas le cas. Ce qui est plutôt grave, non? J’ai fait amende honorable pour ces choses là. Il y a aussi évidemment les amendes que j’ai faites pour des trucs qui datent de quand je buvais, c’était des trucs vraiment graves. Du coup, il y en a tout un éventail…
Quand les gens disent : « cette personne ne veut pas rendre des comptes, », une partie de ce qu’ils veulent dire, c’est que cette personne ne prend pas ses responsabilités. Mais le problème c’est que – il y a plusieurs problèmes en fait. Le premier c’est qu’on essaie de la forcer à prendre ses responsabilités, ce qui est impossible. Et le deuxième, c’est qu’on la dépouille de tout ce dont elle a besoin pour prendre ses responsabilités. Et là on se plaint qu’elle ne prend pas ses responsabilités. Mais elle ne peut littéralement pas faire ça parce qu’on l’a mise au pied du mur, séparée de sa communauté, et son système nerveux est dans une réponse combat-fuiteVI. Elle ne peut pas, elle ne peut d’aucune manière, faire le long et intense travail qu’il faudrait faire. Et pour la plupart des gens, prendre ses responsabilités, ça prend bien plus d’une année pour y arriver. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut demander, et qui va arriver sur un plateau.
Jay- C’est sûr. J’ai déjà vu ce genre de chose arriver à des personnes qui ont fait quelque chose qui n’était objectivement pas ok. Ces personnes ont été cancel. Et ensuite, elles veulent essayer de changer leur comportement et tout ça, mais l’impact de leur cancellation les a fait tourner en boucle psychologiquement jusqu’à ce qu’elles craquent complètement et ne soient plus en mesure de faire la plupart du travail qu’elles avaient besoin de faire.
Clementine- Oui. Et la vitesse à laquelle ça va, c’est dingue. Genre, on t’affiche et là on attend de toi que tu, je cite, « prennes position » genre le jour même ou quoi. C’est absurde.
Jay- Je suis sûr·e que quiconque ayant évolué dans des milieux qui sont très investis dans les trucs du Nexus a vu ce genre de choses se produire encore et encore.
Clementine- Voilà pour la responsabilité. On va passer aux limites.
Jay- Les limites sont un concept important dans beaucoup de trucs de psychologie, de développement personnel et aussi dans beaucoup de trucs de thérapie relationnelle. On trouve que ce concept est tout à fait utile. Pour le définir brièvement, une limite, c’est une barrière qu’on place autour du genre de relations et d’interactions qu’on veut avoir avec les autres. Dans ce sens, une limite c’est quelque chose qu’on fait respecter soi-même. Ce n’est pas quelque chose qu’on force les autres à faire. C’est dire : je vais être en relation avec les personnes qui font ceci, mais pas avec celles qui font cela. Ou alors : j’accepterai tel type de comportement mais pas tel autre dans une relation dans laquelle je suis. Ça signifie que si la personne avec qui on est en relation dépasse cette limite, on la fait respecter en s’extrayant de cette relation. Évidemment on peut avoir d’autres types d’interaction que ça, comme la négociation ou faire des compromis. Mais en soi, une limite c’est quelque chose qu’on fait respecter nous-mêmes.
Clementine- Oui. C’est important que ce soit centré sur toi. Ce n’est pas dire : « tu ne peux pas faire ça, » ou « ma limite c’est que tu ne peux pas faire ça. » Mais plutôt : « ma limite est que je ne sors pas avec des gens qui font ça, » par exemple. Du coup, une limite ça peut être, par exemple : dans une dispute, je ne vais vraiment pas tolérer qu’une personne me crie dessus. Si quelqu’un·e commence à me crier dessus, je partirai. Ça ne veut pas forcément dire que si quelqu’un·e me crie dessus, je vais mettre fin à la relation. Peut-être que oui si cette limite est franchie souvent. Mais en fait, je veux que tu saches que si tu me cries dessus, je vais devoir partir et revenir là-dessus une fois que tu ne seras plus en train de crier. Voilà, ça, ça peut être une limite. Et en fait, ça ne veut pas dire que cette personne n’a pas le droit de crier dans une dispute. Parce que le truc – ça a vraiment été une révélation quand je me suis rendu compte de ça – c’est pas du tout que je n’accepte pas l’acte de crier, c’est que je ne suis pas capable que quelqu’un me crie dessus dans une dispute. Pour moi, ça ne sera jamais acceptable – mais il y a d’autres personnes qui crient en se disputant et c’est un truc qui leur va. Les deux sont ok avec ça. Peut-être que cette personne crie avec son autre ami·e, et les deux se crient dessus quand iels se disputent, et les deux sont tranquilles avec ça. Et c’est ok. Cette personne a le droit de faire ça, parce que les deux personnes se sont mises d’accord sur le fait que ça ne dépasse les limites de personne. Mais si pour toi c’est une limite ça veut dire qu’elle ne peut pas le faire avec toi.
Jay- Ou ça veut dire que la personne peut le faire, mais que tu partiras immédiatement.
Clementine- Voilà, une limite c’est ça. Ce n’est pas dire ce que les autres peuvent et ne peuvent pas faire, c’est dire ce que sera ta réaction s’iels font certaines choses, et comment tu te sentiras par rapport à ça.
On voulait un peu parler d’outils ou de manières d’aborder les limites. Parce que c’est pas un sujet évident, et que c’est vraiment important, fondamental même, et pourtant on ne nous apprend rien là dessus. On ne nous apprend aucune compétence qui permette de savoir vraiment déterminer ce que sont des limites et comment on s’en sert.
Jay- Tout à fait. Et le concept des limites comme quelque chose qu’on fait respecter soi-même c’est quelque chose que j’ai découvert relativement récemment, parce que mon autre partenaire en a entendu parler dans un podcast4. Ça m’a fait halluciner. Je me suis dit : c’est la vérité. C’est très vrai et très important comme information.
Clementine- Oui, complètement. La première chose dont on voulait parler par rapport aux limites, on a déjà un peu approché ça, c’est connaître et communiquer nos limites. Comme Jay l’a dit, pour beaucoup de personnes, connaître ses limites peut être incroyablement difficile. Surtout si on est traumatisé·e et qu’on a grandi dans un environnement où on ne nous autorisait pas à avoir de limites, où on était puni·e pour avoir des limites. Ça a été mon expérience. Du coup, j’avais l’habitude d’aller dans le sens des choses. Et en fait, je me remettais en position d’être victime de trucs ou de dépasser mes propres limites parce que, au fond de moi, je ne savais même pas que j’avais des limites ou comment les faire respecter ni même comment les communiquer. Alors savoir quelles sont mes limites et puis faire un travail sur moi pour apprendre comment savoir que quelque chose est une limite ? Ça peut être vraiment très très dur pour certaines personnes de répondre à cette question, et je conseille de travailler là-dessus avec un·e psy si possible.
Jay- Ou juste en parler avec des ami·es ! Avoir une bonne conversation bien profonde avec tes ami·es. Genre qu’est-ce que tu penses qu’il y a comme limites dans notre relation ? Et s’asseoir autour de la table et –
Clementine- Et se demander, comment on sait ? Comment on sait que ça, c’est une limite ? À un moment, j’allais chez une psy que j’avais vue que deux ou trois fois, et elle a voulu essayer un exercice sur les limites avec moi : j’étais debout dans la pièce et elle était de l’autre côté de la pièce. Et elle disait : « je vais faire un pas en avant. Je veux que vous ressentiez ce que ça produit dans votre corps et que vous me disiez stop dès que c’est la limite et que vous ne voulez pas que je m’approche plus. » Elle avait à peine eu le temps de faire un demi-pas et j’ai dit « stop. » Et en plus de ça j’étais tellement mal à l’aise que je l’ai jamais revue. Et honnêtement, je pense qu’elle a fait de son mieux. Mais je suis tellement traumatisé·e que ce genre d’exercice physique était bien au-delà de ce que je pouvais supporter. J’étais complètement triggerVII. Évidemment, il fallait que je commence à un niveau bien plus bas pour faire ce genre de travail. Mais c’est de là que je suis parti·e. Je me sentais complètement agressé·e juste avec quelqu’un qui avance vers moi. Qu’on attende de moi de le verbaliser en plus, putain, c’était hyper dur. Alors oui. Ça demande beaucoup de travail. Y a aussi moyen d’utiliser l’écriture ou de tenir un journal pour démêler ces trucs là.
Jay- Pour ma part, un des trucs que j’ai mis beaucoup de temps à comprendre c’est qu’une de mes limites consiste à avoir besoin qu’on me laisse de l’espace parfois. Particulièrement après les disputes et ce genre de choses, je deviens très – mon besoin de solitude est tellement fort que ça prend le dessus sur tout le reste. Et ça m’a pris beaucoup de temps de comprendre que c’était une limite et que je pouvais la formuler de manière claire. Plutôt que de déconner avec ça et de disparaître sans explication. Ce qui peut être vraiment blessant pour les autres.
Clementine- Complètement. Il faut dire les choses, parce que les gens vont donner du sens à nos actes. Du coup, dans cet exemple de toi qui a l’air de disparaître – une personne peut imaginer un sens à ça, comme par exemple que tu lui en veux. Mais si tu lui a déjà dit que c’est une limite ou un besoin que tu as, alors elle n’a pas à s’imaginer le sens que ça a. Elle sait que c’est quelque chose qui arrive avec toi. Dire les choses, comprendre ce que sont nos limites puis les dire, c’est crucial. Et purée, ça peut être hyper dur. C’est super dur de verbaliser des trucs. J’encourage vraiment les gens à en parler dans tous les types de relations et à s’y entraîner. À se demander les un·es les autres où sont nos limites, à voir ce que ça fait de les dire. Et des fois il y a des exercices qu’on peut faire, qui sont un peu ridicules, mais genre – si dire « non » c’est super dur pour toi, ou que ça te trigger, c’est possible de s’entraîner avec des choses complètement inoffensives. Demander à un·e pote de te dire « tu peux allumer la lumière ? » Et toi tu dis « non. » Ça a l’air bête comme exercice mais ça fait s’entraîner à dire « non, c’est une limite. Je n’allume pas la lumière. » [rires]
Jay- « J’aime les ténèbres ! »
Clementine- Il faut parler de nos limites et ensuite, respecter les limites des autres. Du coup, les gens vont nous dire leurs limites, et il faut qu’on les respecte. Des fois, ça ne nous met pas à l’aise. Des fois on a envie de contrôler les autres. Et c’est vraiment bizarre. Je pense que le Nexus et la cancel culture sont vraiment portées sur le contrôle. Il y a une obsession de contrôle des autres. Et pourtant dans le Nexus, on fait genre « non, on ne fait jamais ça. À aucun moment on n’aime contrôler les autres. » On a tendance à renier ce désir et cette pulsion. Mais c’est une pulsion complètement humaine. Tout le monde ne l’a pas, mais je pense que c’est très courant d’avoir le désir de contrôler les autres et d’obtenir ce qu’on veut – et même pas forcément de manière mal intentionné·e, mais de manière à se sentir en sécurité, ou à ce que ça corresponde à nos besoins, ou quoi. On peut vouloir vraiment fort contrôler les autres. Ce n’est pas mauvais en soi, c’est juste qu’il faut trouver une manière d’agir sans être poussé·e par ça, et de respecter les limites des autres même quand c’est difficile ou inconfortable pour nous.
La prochaine partie c’est le compromis. Les limites ne sont pas toujours des limites rigides. Parfois si, ce sont des situations rédhibitoires et non-négociables. Et parfois on se rend compte que les limites de deux personnes ne fonctionnent pas ensemble. Ça ne veut pas dire que quelqu’un se comporte mal. Ça peut être deux personnes qui s’aiment bien, qui veulent avoir un certain genre de relation ensemble, mais elles se rendent compte que leurs limites sont complètement incompatibles. Et si elles en ont parlé, et qu’elles communiquent bien, elles devraient s’en rendre compte assez tôt pour qu’il n’y ait pas des tonnes de sentiments douloureux quand elles réalisent que leurs limites sont hyper incompatibles et que la relation peut ne pas fonctionner. Ça arrive. C’est complètement normal. Alors plus il y a de communication, mieux c’est. Mais il y a aussi des limites qui font se demander : est-ce que c’est une limite rigide, ou est-ce que c’est plutôt un désir ou une requête ? On peut se rendre compte que quelque chose qu’on pensait être une limite très rigide est en fait plus fluide qu’on pensait. C’est délicat, parce qu’on peut aussi se retrouver à faire quelque chose juste par crainte de perdre une relation. Du coup, c’est un peu… on dépasse nos propres limites en faisant comme si ce n’était pas une limite mais juste un désir. Alors c’est subtil. Savoir ce qui est vraiment une limite rigide pour nous et ce sur quoi on peut être plus flexible, ça demande de bien se connaître.
Et c’est aussi vrai que les limites changent, non ? Quelque chose a pu être une limite rigide à un moment de la vie, et un jour on se dit : « en fait, ça n’est plus une limite rigide pour moi. » Et c’est normal. On peut aussi se rendre compte tout d’un coup d’une nouvelle limite qu’on n’avait pas avant. Tout ça demande de la communication et ça peut aussi changer nos relations à mesure qu’on intègre de nouvelles limites à des relations existantes.
Jay- Oui. Et certaines personnes font une très grande distinction entre les limites, les envies et les besoins. Mais en vrai j’ai l’impression que c’est un spectre assez vague. Des fois les limites ont effectivement besoin d’être négociées. C’est bien et c’est normal. Bien que si une limite est très stricte, dans ce cas on ne veut pas la négocier. Et c’est aussi très bien.
Clementine- Oui. Et, c’est vrai que toutes les limites sont valides. Ça pourrait être une limite qui a l’air complètement absurde pour quelqu’un d’autre, mais ça reste le choix de cette personne de décider que c’est une de ses limites. Par exemple, « je ne parlerai qu’à des personnes qui portent des vêtements bleus. » C’est un peu ridicule. Mais c’est ok. Ça veut juste dire que tu ne pourras probablement pas parler à beaucoup de gens. Et tu peux avoir cette limite, mais ça veut aussi dire que les gens ne vont pas vouloir se changer pour mettre des fringues bleues à chaque fois qu’ils veulent te parler. Ça peut donc impacter ta capacité à nouer des relations. Mais il doit toujours nous être permis de déterminer nos propres limites, et les autres doivent pouvoir décider si cette limite fonctionne ou pas pour elleux. Si ça n’est pas le cas, ça peut vouloir dire que la relation ne va pas marcher. On s’évite plein de problèmes dans le futur si on est explicite avec ces trucs là. On présuppose des tas de choses sur les limites des gens mais si on en parlait et qu’on échangeait là dessus, on dénouerait beaucoup de dramas. Du coup, j’encourage les gens à commencer à en parler.
Vu que je m’y connais en trauma et en théorie de l’attachement5, je pense qu’un gros problème, c’est que, pour les personnes qui ont des traumatismes autour de l’abandon et du fait d’être seules, pour qui être seule est vraiment insupportable ou qui ont peur de perdre les liens qu’elles ont, l’idée de dire : « c’est ma limite et c’est une limite rigide et si cette personne ne l’accepte pas, ça veut dire que la relation est finie, » ça peut être terrifiant. Parce que ce qui leur fait peur ce n’est pas juste le fait d’être seule mais c’est aussi le traumatisme de l’attachement que ça ravive. Mais si on fait comme si quelque chose n’était pas une limite rigide alors que c’en est une, et qu’on dépasse nous-mêmes nos limites, ça ne nous fait pas du bien, et ça ne fait pas du bien à l’autre personne non plus. Ce qui finit par arriver, c’est qu’on peut se retrouver à avoir accumulé des tonnes de rancœur contre l’autre personne, parce qu’on avait consenti à une dynamique qui allait en fait à l’encontre de nos limites. Et c’est aussi bizarre parce que, d’une certaine manière, on franchit aussi les limites de cette autre personne, parce qu’elle veut être dans une dynamique consentie et qu’elle pense l’être vu qu’on lui a dit que c’était le cas.
Je pense qu’un tas de gens font ce genre de chose. Ce n’est pas de la malveillance, on n’est pas en train de dire « t’es vraiment une mauvaise personne. » C’est sûr que j’ai déjà fait ce genre de trucs. J’étais dans des relations qui ne collaient pas avec mes besoins et je me disais : « j’ai trop peur de perdre cette relation. J’ai qu’à continuer à faire comme si ça le faisait. » Au final, ça n’a vraiment aidé personne. Alors c’est dur. Je crois que la théorie de l’attachement ça peut vraiment aider. On va noter quelques ressources sur la page du podcast, si jamais ça intéresse du monde d’aller voir du côté des trucs de trauma, de théorie de l’attachement, de système nerveux. Voir un·e psy et travailler sur ces problèmes qui sous-tendent le reste, ça peut vraiment aider à devenir capable de dire non quand on a besoin de dire non.
Jay- Oui. On a mentionné le fait que les limites c’est quelque chose qu’on fait respecter nous-même, n’est-ce pas ?
Clementine- Et qu’on est responsable de les faire respecter.
Jay- C’est notre responsabilité de les faire respecter. Clementine et moi en avons parlé par le passé : dans un contexte de kink ou de BDSM, si on consent activement à quelque chose qu’on n’a pas vraiment envie de faire en réalité, on peut mettre une autre personne dans une situation risquée et en mauvaise posture, non ? Donc on est bien responsable d’essayer de comprendre quelles sont nos limites.
Clementine- Carrément, et c’est vrai dans toutes les situations, pas que dans des contextes BDSM et kink.
Jay- Oui c’est sûr. C’est juste un type particulier de –
Clementine- Complètement. Parce que dans cette situation là, quand tu demandes à quelqu’un de faire des trucs vraiment extrêmes – c’est un peu bizarre et hors-sujet… En fait je pense que les doms peuvent être dans la position la plus vulnérable. Parce que tu fais plein de trucs complètement dingues, et tu dois avoir confiance dans le fait que cette personne veut que tu fasses ces trucs, et que c’est quelque chose de consenti. Et toute personne saine, et non-abusive ne veut évidemment pas participer à une dynamique non-consentie méga hardcore. Alors il faut avoir confiance.
Bon, c’est pas un podcast BDSM, mais je viens de prendre une tangente BDSM. Le truc c’est que, quand j’ai commencé à faire de la dom, je me disais : « Bordel de merde, je me sens tellement plus vulnérable. » Parce que c’est moi qui lance les choses et qui prend la responsabilité de l’action et j’ai une sacrée confiance dans le fait que cette personne va bien avoir recours aux putain de signaux dont on avait convenu si elle a besoin que les choses changent ou s’arrêtent. Alors, oui. C’est de notre responsabilité de dire nos limites. Et quand on ne communique pas nos limites, on peut en fait dépasser les limites des autres. Parce que les gens pensent s’être engagés dans une dynamique consentie alors que ce n’est pas le cas.
Jay- Voilà. Après, là où ça devient compliqué, déprimant et sinistre c’est qu’il y a des situations où on ne peut pas faire respecter nos propres limites pour une raison ou une autre. Ça signifie qu’on ne peut pas partir. On ne peut pas s’extraire de la situation, ou de la relation. Ce sont des situations d’abus où on est en danger pour une raison ou une autre, ou alors l’autre personne a un moyen de pression sur nous. Cette personne peut nous forcer par la menace par exemple. Elle peut avoir du pouvoir sur nous, elle a peut-être de quoi nous faire du chantage. Elle peut menacer notre animal de compagnie. Des choses comme ça. Dans ces situations c’est différent. Parce qu’on ne peut pas juste affirmer nos limites avec quelqu’un qui n’en a rien à foutre.
Clementine- Et là-dedans il y a plusieurs degrés aussi. Tu parles d’une situation de violence domestique très intense et flippante. Mais il y a des degrés. Je pense qu’il y a deux niveaux pour faire respecter nos propres limites. Le premier c’est dire « ne me hurle pas dessus quand on se dispute. » Et si la personne continue à faire ça, la prochaine étape est « je mets fin à cette relation. » Donc, on a pu faire respecter notre limite dans une certaine mesure, mais on n’a pas pu faire respecter notre désir premier. Mais maintenant on part, et on peut faire respecter cette limite, de manière plutôt définitive.
Jay- On a été capable de stopper ce comportement, en partant.
Clementine- Exactement. Mais il y a des situations de violence grave, comme celles dont parle Jay et dans lesquelles, pour différentes raisons, on est littéralement pris·e au piège. Les enfants, par exemple, n’ont pas le pouvoir de quitter une situation de violence. Et en ce qui concerne les adultes, il y a des situations de violence domestique où on a des enfants et/ou des animaux domestiques qui sont menacés, où la violence physique est utilisée pour nous contrôler, etc. Alors on n’a pas la possibilité de faire respecter notre limite. Un autre exemple dans le même registre, c’est une agression en elle-même. Si une personne nous agresse, genre physiquement, en nous frappant ou autre, il se peut qu’on ne soit pas assez fort·e ou assez rapide pour l’empêcher de le faire. Notre limite a beau être « ne me frappe pas » – comme on l’a dit tout à l’heure, on doit partir du principe que c’est une limite implicite – si quelqu’un viole cette limite et commence à nous frapper, il se peut que, de nous-mêmes, on ne soit pas capable de l’arrêter. Et c’est ça la violence, c’est ça que ça veut dire « violence. »
Jay- Oui. Le harcèlement en est un autre exemple. Ces actes sont souvent perçus comme étant plus graves, justement parce que la victime n’est pas en mesure de les faire cesser.
Clementine- Oui. C’est une part importante de comment on identifie les situations abusives. Si une personne fait quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui franchit nos limites, mais qu’on est capable de dire « Je fais respecter ma limite et c’est fini maintenant, » alors ce n’est pas une situation abusive, parce qu’on a pu faire respecter notre limite et partir. Mais si on ne peut agir d’aucune façon pour que ça s’arrête, qu’on nous enferme dans cette situation, c’est là que c’est abusif. Et – controverse – je pense que c’est important et intéressant de faire remarquer que les campagnes d’ostracisation tombent dans cette catégorie de situation abusive. Quand on te cancel et qu’on te harcèle, le harcèlement est incessant. Il ne s’arrête jamais. On est incapable de faire en sorte qu’il s’arrête. Si on dit : « ma limite, c’est que je ne veux pas que des centaines d’inconnu·es continuent de me tagger, de m’envoyer des messages, de dire à mes ami·es de ne plus être mes amies – ce comportement me plonge dans la détresse et je ne veux pas que ça arrive, » bonne chance pour faire respecter cette limite ! Ça n’arrivera pas hein ? C’est en partie pour ça que la cancel culture est abusive. Parce qu’elle empêche une personne de faire respecter ses propres limites, de quelque manière que ce soit. Si on dit « je veux que tu arrêtes, » cette personne est censée arrêter. Dans la cancel culture, ça ne marche pas comme ça. Et ça nous mène au concept d’intervention.
Jay- Oui. Très souvent, ce qui est appelé « rendre des comptes » est emballé dans le langage de l’intervention, mais d’une manière très vague, ce qui fait que, comme nous allons le montrer, ça ne donne pas lieu à une véritable intervention.
Clementine- Oui. Très souvent, la justification pour cancel des gens c’est de dire que c’est une intervention, alors qu’en fait ç’en n’est pas une.
Jay- En gros, on peut diviser les interventions en deux catégories : des interventions douces et des interventions fortes. Les douces, comme on peut l’imaginer, sont à peine des interventions. Ça peut être qu’on remarque quelque chose qui ne va pas vraiment et qu’on en parle à nos ami·es. Disons par exemple que tu as un ami, et que tu remarques qu’il dévalorise sa copine de manière bizarre. Tu peux lui dire un truc du genre : « Je ne comprends pas pourquoi tu avais besoin de dire qu’elle ne cuisine pas bien devant tout un groupe de gens pour zéro raison. C’était un peu bizarre et brutal. » Tu peux causer avec ton ami et lui dire « je ne sais pas si tu as remarqué mais ta copine a eu l’air vraiment triste quand tu as dit ça. » Et ensuite tu as une discussion avec lui. Autre exemple, tu peux remarquer que ton·ta pote partage de plus en plus de publications qui ont l’air sorties de sites conspi chelous. Tu pourrais dire « hey, j’aimerais bien qu’on parle de tes sources d’information. Je pense que ça pourrait t’intéresser d’avantage d’aller voir cette super publication d’extrême-gauche, Jacobin. » Etc. Je suis sûr·e que vous pouvez trouver encore d’autres exemples vous-mêmes. Ce qui distingue une intervention douce c’est qu’à aucun moment il n’y a de la coercition. Et on ne dépasse pas les limites d’une personne en lui faisant un retour. On est juste en train de parler, d’ouvrir un dialogue.
Clementine- Il n’y a aucun moment où on la force à quoi que ce soit.
Jay- Oui, et je pense que c’est toujours bien et approprié d’essayer d’inviter quelqu’un à discuter de bonne foi. Je n’arrive pas à imaginer de situation où ça n’est pas pertinent.
Clementine- Oui. On a le droit de faire ça quoi qu’il arrive. On peut être en désaccord avec les gens, et ils peuvent tenir compte de notre retour ou pas. Ils ont tout à fait le droit de ne pas en ternir compte. Ils peuvent dire : « merci de me dire ça. Je ne suis pas d’accord. Je vais continuer à faire ce que je fais. » Une intervention légère c’est pour les situations où on fait un retour. Ce n’est pas une situation qui nécessite qu’on essaie de forcer les gens.
Jay- Non, c’est juste le genre d’interaction qui maintient la cohésion d’une société.
Clementine- Et qui encourage la responsabilité.
Jay- C’est à distinguer de ce qu’on pourrait appeler une intervention forte. Une intervention forte utilise la force. Littéralement. Elle dépasse les limites d’une personne. Et la raison pour laquelle elle le fait est très spécifique. C’est pour l’empêcher de dépasser les limites de quelqu’un·e d’autre d’une manière particulièrement grave, dans une situation qui est en train de se produire, ou qui est tellement régulière qu’on est sûr·e, au-delà d’un doute raisonnable, que ça va se reproduire.
Clementine- Oui. C’est très très important. Parce que le le fait d’user de la force contre une autre personne, c’est un truc vraiment extrême. Ça viole l’autonomie de cette personne. Ça l’entrave physiquement ou alors via du harcèlement qui a pour but de lui faire faire ce qu’on veut qu’elle fasse, et c’est une énorme violation.
Jay- Oui, et en tant que personnes qui s’intéressent à l’anarchisme et qui ont une perspective anarchiste sur beaucoup de choses, on pense fortement que pour faire un truc comme ça, il faut avoir une putain de bonne raison.
Clementine- Oui. L’autonomie c’est fondamental. C’est une de ces limites implicites que tout le monde a. Contrôler d’autres personnes, les forcer à faire quelque chose ou transgresser leurs limites c’est pas ok. Donc pour faire ça, il faut vraiment avoir une extrêmement bonne raison. Un exemple clair et net que j’aime donner c’est que si je chopais une personne et que je la maîtrisais en l’empêchant de bouger, ça serait une énorme violation de son autonomie physique. Je n’ai aucun droit de débarquer devant quelqu’un·e et de læ retenir physiquement sans son consentement. Par contre, si cette personne est sur le point de frapper quelqu’un·e d’autre et que je l’en empêche en la retenant physiquement, je m’en prends à son autonomie physique, mais je le fais dans le seul but de l’empêcher de violer celle de cette autre personne. Et c’est ça qui me donne la permission éthique de faire ça dans cette situation. Je ne suis autorisé·e à faire ça à cette personne dans aucune autre situation, parce que ça serait injuste. C’est ça que ça veut dire intervenir. Ça ne veut pas dire qu’à chaque fois que les gens font des trucs qu’on n’aime pas, on a le droit de les forcer à se comporter de la manière dont on veut qu’ils se comportent. C’est pas correct. Dans la cancel culture, les gens galèrent à comprendre ça parce qu’ils croient réellement avoir le droit et l’autorité éthique de faire usage de la force, souvent via ces campagnes de harcèlement et d’intimidation méga intenses, pour pousser une personne à agir de la manière dont ils veulent qu’elle agisse.
Jay- Ou à penser ce qu’ils veulent lui faire penser.
Clementine- Oui. Et ils pensent qu’ils ont le droit de faire ça parce qu’ils se disent : « j’ai les bonnes positions politiques et éthiques, donc j’ai le droit d’imposer ces positions. » Mais, franchement, c’est extrêmement arrogant comme posture. Les questions politiques et éthiques sont extrêmement complexes. Je ne crois pas que quiconque puisse se vanter d’avoir toutes les réponses. Et de penser qu’on a le droit d’enfreindre les limites de quelqu’un·e dans le but d’imposer aux autres notre version de ce qui est éthique, à mon avis, c’est complètement indécent. Si on intervient en faisant usage de la force, il faut que ce soit hyper clair qu’on fait ça pour empêcher une personne de violer gravement les limites d’une autre. Si on est témoin d’une agression en train de se produire, on a le droit d’intervenir physiquement là-dedans. Mais – et c’est là que ça se complique un peu – si on sait qu’une personne a des comportements récurrents qui violent profondément l’autonomie physique d’autres personnes, et qu’on sait que c’est un comportement qu’elle continue à avoir encore et encore, alors c’est une situation dans laquelle prévenir les gens ou peut être exclure cette personne d’espaces spécifiques peut être judicieux. Les gens font souvent comme si c’était ce qu’il se passe dans la cancel culture. Quand quelqu’un·e a vaguement été accusé·e de « faire du mal, » on se dit que c’est ok de læ harceler et on fait comme si ça revenait à prévenir les gens que cette personne est dangereuse. Souvent, c’est une punition déguisée en intervention. On veut juste que les gens ne s’en sortent pas comme ça. On veut qu’ils souffrent. Et du coup, on fait comme si on prévenait les gens contre cette personne en disant à tout le monde autour de la harceler. Mais ces accusations sont souvent extrêmement vagues. On a très peu d’informations, et pourtant on a hyper fort envie de foncer et de détruire la vie de cette personne sur ces bases-là. Les raisons pour lesquelles on fait ça doivent être très claires et précises. Il faut que ce soit parce qu’on a une très très bonne raison de penser que la personne n’a pas cessé d’avoir ces comportements abusifs. Et il faut que l’intervention soit spécifique au domaine dans lequel la violation de limite se produit, et ça aussi c’est quelque chose d’assez controversé.
Jay- Oui. Beaucoup de personnes ont l’air de penser que si quelqu’un·e a « fait du mal », tu sais, avec les guillemets là, on doit l’empêcher d’avoir accès à la vie, en gros. Cette personne ne devrait plus avoir le droit d’aller à des événements. Ni de côtoyer qui que ce soit.
Clementine- Ni d’avoir un travail, une communauté, des activités ou des choses dans lesquelles s’impliquer.
Jay- C’est ça. C’est rarement énoncé aussi franchement, mais c’est souvent ce qui finit par arriver quand on appelle ton taff pour te faire virer, et qu’on passe des coups de fil pour te bannir de tous les lieux que tu fréquentes. Dans ce cas, ces mesures – très souvent en tout cas – n’ont littéralement aucun rapport avec l’infraction qui est présumée. Donc si le truc que tu as fait c’est que tu as dit quelque chose sur internet que ces personnes n’aiment pas, et qu’elles appellent ton taff pour te faire virer, mais quel foutu rapport est-ce que ça a avec ton taff ? Et surtout si on est socialiste, c’est vraiment ridicule de menacer l’emploi d’un·e travailleur·euse en raison d’une opinion politique.
Clementine- Oui. Et puis, donner ton avis sur internet, tweeter un truc ou quoi, ça ne viole l’autonomie de personne.
Jay- C’est vrai, et inévitablement on en arrive à la question de la liberté d’expression. Les gens ont des opinions variées sur la liberté d’expression. Et je pense que c’est bien. C’est un sujet difficile. Mais certaines personnes sont très absolutistes à propos de ça, et d’autres le sont moins. Je pense qu’il est très important que si on envisage d’empêcher quelqu’un de dire quelque chose par la force, en gros une intervention forte, il faut qu’on ait une très bonne raison. Honnêtement en ce qui me concerne, je pense que le seul scénario où je veux bien nourrir l’idée que censurer quelqu’un est une bonne idée, c’est vraiment dans une situation où il y a un appel à la violence qui est fait contre une personne ou un groupe identifiable. Ou s’il s’agit de recrutement actif pour une organisation de suprémacistes blancs, de terroristes ou quelque chose comme ça.
Clementine- Oui, et la motivation derrière ça, c’est qu’on a d’assez bonnes indications sur le fait que ces personnes projettent de violer gravement et profondément l’autonomie des gens. C’est ça qui justifie ce genre de réaction.
Jay- Oui, et ça n’est pas nécessaire d’être d’accord avec moi à cent pourcent là-dessus, mais je pense que c’est important de reconnaître que la liberté d’expression, la liberté de discours – la liberté en général – sont des choses pour lesquelles nos ancêtres se sont battu·es pendant des générations, des centaines d’années, des milliers d’années. Et, bien évidemment, le système dans lequel on vit aujourd’hui n’est pas une utopie et il n’est pas parfait, mais ces libertés qu’on a réussi à atteindre sont très importantes à mon avis, elles valent le coup d’être protégées, et ce sont des idéaux que la plupart des gens trouvent très bénéfiques et puissants, et dignes qu’on les défende en tant que personnes de gauche. Traditionnellement les gens de gauche ont défendu longtemps ces choses là, et on devrait continuer à le faire.
Clementine- Absolument. Le truc c’est qu’une fois qu’on commence à être vague sur ce qui demande une intervention forte, les gens peuvent en faire ce qu’ils veulent. Parce qu’on n’est pas tou·te·s d’accord sur les choses et donc dans une situation, une personne va penser qu’on a le droit d’utiliser la force pour y mettre un terme, et une autre se dira « quoi ? C’est juste une personne qui donne son avis en fait. » Du coup on arrive en terrain très dangereux, où les gens vivent d’énormes violations de leurs limites juste parce qu’ils exercent leur liberté fondamentale.
Bon, on a dérivé sur la liberté d’expression et internet. Je pense que l’intervention est très rarement appropriée pour des trucs sur internet, parce que, de par sa forme, internet n’a rien à voir avec les limites des gens. Parce que sur internet, tu peux littéralement cliquer sur « unfollow. » Tu peux ne pas regarder. Personne ne t’y oblige. Du coup, ce n’est pas une violation de tes limites. Sauf dans les cas extrêmes dont Jay a parlé, où c’est un genre d’appel à passer à l’acte et à enfreindre les limites des gens, et dans ce cas, je pense que c’est judicieux d’intervenir.
Jay- C’est sûr. Et c’est marrant parce que les gens essayent toujours de placer une variante de cet argument, en mode « tu essayes de censurer les personnes qui veulent cancel des gens. » Mais en fait non, ça n’est pas ce qu’on fait. On pense qu’il ne faudrait pas cancel des gens, mais on pense aussi qu’on n’a pas à être harcelé·e, viré·e, calomnié·e ou quoi si on le fait.
Clementine- Il y a une différence entre donner son opinion et harceler quelqu’un·e. Si tu critiques les idées de quelqu’un·e, fonce ! c’est pas ça de cancel quelqu’un·e. Si tu postes juste ton propre tweet dans lequel tu dis, « j’ai lu ce qu’écrit cette personne et je ne suis pas d’accord avec ça. Et voilà pourquoi je pense que ce qu’elle a dit n’est pas vrai du tout, et même vraiment mauvais. » Ou un truc dans le genre… on peut complètement faire ça. La question c’est, est-ce que t’es en train de rameuter du monde pour aller harceler cette personne ? Est-ce que tu incites des tonnes de gens à envoyer des messages privés à cette personne et à la harceler ? Est-ce que tu demandes à ce qu’elle soit exclue de la plateforme ? Est-ce que tu appelles sa·son patron·ne ? Est-ce que tu fais ça pour que chaque jour elle se lève en croulant sous des tonnes et des tonnes de messages de harcèlement ?
Jay- Est-ce que tu essayes de la faire virer de son école – ce genre de trucs.
Clementine- Oui, tout ça c’est du harcèlement en fait. C’est pas juste toi qui expose ton point de vue, c’est du harcèlement. Et c’est une forme d’usage de la force. Tu utilises la force pour essayer de faire faire à cette personne ce que tu veux qu’elle fasse, et il vaudrait mieux que tu arrêtes. Parce que c’est une violation de ses limites. Et les seuls cas dans lesquels ce genre de truc est pertinent – et il y a des situations dans lesquelles c’est pertinent – c’est quand cette personne viole gravement les limites d’une autre personne et qu’il faut l’en empêcher. Je crois qu’on a compris, mais je voudrais juste clarifier que l’intervention doit être précise. Ce que ça veut dire c’est que, dans le cas où on devrait prévenir – ok, je vais dire quelque chose de très controversé et ça va mettre du monde en colère, mais je vais juste le dire.
Disons qu’une personne en a agressé une autre plusieurs fois. Disons même que cette personne a eu plus d’une relation dans laquelle elle a agressé sa·son partenaire. C’est vraiment grave. Dans ce cas, je trouve que ça ferait sens de parler de ça à sa·son nouvelle·eau partenaire. Ça serait une intervention dans laquelle on divulgue une information sans le consentement de cette personne, mais on fait aussi ça pour protéger l’autre personne de potentiellement se retrouver avec ses limites très gravement violées. Dans certains cas, je pense même que prévenir les gens publiquement, genre sur internet, à propos d’une personne en particulier, ça peut être pertinent, si cette personne a très gravement, encore et encore, enfreint les limites d’autres personnes. Par contre, cette intervention doit être centrée sur ses relations amoureuses, parce que c’est là qu’a lieu la violence. Par exemple, que cette personne soit dans un groupe de musique, ça n’a rien à voir avec le fait qu’elle agresse des gens. C’est des choses différentes. La personne qui fait un groupe, c’est juste la personne qui fait un groupe. Appeler tout le monde à boycotter ou à faire splitter son groupe parce qu’on pense qu’elle ne devrait pas agresser des gens, ce n’est pas de l’intervention.
Jay- Tout à fait, parce que c’est des choses différentes. Ça pourrait être différent si la personne couchait avec des groupies et les agressaient elles·eux par exemple, dans ce cas son groupe serait une cible plus pertinente. Mais en fait la question c’est qu’une personne ait l’opportunité de s’épanouir en tant qu’humain·e – dans cette situation en étant musicien·ne, ce qui lui fait du bien, lui donne un moyen de s’exprimer, etc – ça n’a pas de lien avec le type d’intervention qu’on essaye de faire.
Clementine- Exactement. Et les gens peuvent trouver ça vraiment trigger, et se mettre dans tous leurs états, mais je crois que si on regarde au fond ce qui motive le geste ici, il faut reconnaître que c’est la punition. Parce que le fait que la personne soit dans un groupe n’a rien à voir avec les situations dans lesquelles elle a été violente. Du coup, si le but c’est de mettre fin à la violence, alors l’intervention doit être précisément orientée vers prévenir les gens qui ont des relations intimes avec cette personne, ou qui pourraient commencer des relations intimes avec cette personne. Dans le meilleur des cas, l’intervention peut inclure des ami·es de confiance qui proposent d’aider la personne à trouver un·e psy, un groupe de parole et tout ce dont elle peut avoir besoin. Mais qu’elle soit dans un groupe est complètement hors-sujet. La pulsion d’enlever des trucs chouettes aux personnes qui ont agi de manière abusive ou qui ont dépassé les limites des autres, c’est une pulsion punitive. C’est l’envie de dire, « tu ne mérites plus d’avoir ça. Un groupe c’est un privilège. C’est un truc chouette. Et on peut t’enlever ça. » Fondamentalement, je ne suis pas d’accord avec ça. Je pense que les êtres humain·es ont le droit d’avoir de belles vies, pleines et entières, même quand iels ont fait des choses objectivement abusives ou qui ont franchi les limites des autres et tout. Les gens peuvent être en désaccord avec moi là-dessus. Ils peuvent penser que ce n’est pas vrai. Et c’est ok, je ne suis pas d’accord avec eux, mais je crois que c’est très important qu’on se mette au clair sur le fait que c’est une question distincte de l’intervention. Ça embrouille l’histoire quand on fait comme si dépouiller les gens de trucs qui n’ont rien à voir était une manière d’intervenir sur la violence. Il y a besoin qu’on soit précis·es. Tu peux penser que c’est ok de faire ça. Tu peux penser que cette personne ne mérite pas d’être dans un groupe. Mais appelle les choses par leur nom : tu penses qu’une personne qui agi de manière répréhensible n’a plus le droit d’avoir un groupe. Ça peut être une posture que tu défends, mais ça ne s’appelle pas intervenir sur la violence.
Jay- Oui. Et c’est raisonnable que des gens remettent en question cette posture.
Clementine- Oui. Donc je la remets en question.
Avant d’aller plus loin, je veux juste parler de quelques exemples concrets d’intervention. Parce que Jay et moi on a tou·te·s les deux de l’expérience avec ce genre de trucs, et je pense que même si dans le Nexus on parle sans arrêt de l’idée de rendre des comptes et de cancel culture, il n’y a personne pour nous appendre des choses à propos de l’intervention. Je dirais que l’intervention est probablement le truc le plus important -enfin, l’intervention ou la responsabilité, je crois que les deux sont vraiment des trucs bien. Mais intervenir c’est une compétence tellement importante, parce que la violence est juste atroce. Si ça arrive, c’est ma putain de responsabilité d’intervenir. Et je prends ça très au sérieux. Je ne prends pas la violence à la légère, si je vois un truc se passer, j’y mets un putain de stop. Et je crois que pas mal de monde dirait « Tu déconnes Clementine ? » genre qu’est-ce que tu veux dire par là ? Je fais littéralement 1m50, comment je fais pour y mettre un putain de stop ? Et bien je peux le faire, et j’ai beaucoup d’expérience avec ça. Je ne dis pas que tout le monde sera forcément à l’aise pour intervenir dans une situation violente. Mais je pense que si on cultive cette compétence, et que de plus en plus d’entre nous se sentent capables et en confiance pour faire ce boulot, ça travaille à construire des communautés plus sûres. Du coup, est-ce que tu as des trucs à dire là-dessus Jay, parce que je sais que tu as de l’expérience ?
Jay- Oui ! J’ai de l’expérience en tant que travailleur·euse social·e, dans un contexte de travail avec des personnes sans-abri. Ou de manière générale des personnes de la rue. Au premier endroit où j’ai fait ce taff là, l’intégralité de mon travail consistait à intervenir constamment, parfois dans des situations plutôt violentes. Je me suis pris des coups plein de fois. Heureusement c’était surtout des coups au ralenti et mous à cause de l’alcool. Mais bon. Quand tu vois deux personnes qui sont sur le point de se mettre sur la gueule, tu peux physiquement mettre ton corps entre elles deux . Ça n’est pas toujours la meilleure idée, mais ça arrive. En général ce qu’il faut faire c’est identifier la personne qui a l’air la plus disposée à interagir avec toi, et il faut solliciter cette personne et essayer de la faire s’éloigner avec toi. Par exemple, on peut avoir un type qui est complètement déchiré et un autre type qui est simplement vénèr parce que le mec déchiré n’arrête pas de lui rentrer dedans, et essaye de le frapper. Le gars qui est le moins bourré va être le plus apte à te regarder dans les yeux, et se dire genre « Hey c’est Jay. Je connais Jay. » Et après tu peux lui dire « Hey mon pote. Pourquoi tu viendrais pas fumer une cigarette avec moi ? Laisse tomber ce mec, il est juste en train de faire le con. » Et il peut dire « Ouais, quel sale con ! » ou encore, « Ouais il fait le con. On se casse. »
Clementine- C’est de la désescalade.
Jay- Oui. Ou alors, il peut y avoir une personne qui est méchamment défoncée au crack et qui essaye de frapper quelqu’un. Sauf qu’elle mesure genre 1m50 et si elle frappe ce géant elle va se faire balancer à l’autre bout de la pièce. Et là tu te dis, okay, je vais mettre mon corps entre les deux. Si elle me frappe, ça n’est pas si grave que ça. Parce qu’elle est petite et je peux l’encaisser. Après je peux essayer de l’attraper par l’épaule et la déplacer juste un petit peu plus loin puis la distraire ou quoi. Je parle de ces situations très précises dans un contexte de foyer pour sans-abris, ou d’interventions dans la rue, ce genre de trucs, mais ça marche plutôt bien dans plein de ces contextes. Et ça peut s’appliquer à deux personnes qui sont, par exemple, trigger comme pas possible et qui se hurlent dessus, qui ont un genre de dispute. Il n’y a pas besoin que ça soit des personnes violentes ou quoi. Mais on peut souvent dés-escalader en allant chercher celle qui semble la plus disposée et essayer d’interagir avec elle jusqu’à ce qu’elle soit moins émotionnellement affectée.
Sinon, un jour Clementine et moi on marchait dans la rue et on a vu une scène où un gars criait sur une femme et ça avait l’air de commencer à chauffer. Alors on est venu·es se mettre à côté. Et Clementine se tenait là en mode, je reste ici pour regarder ce qui se passe. Je me suis mis·e entre les deux, j’ai parlé au type. J’étais en mode « Nan mais on dirait que cette femme était sur le point de partir, ça va aller. » Et il a dit « Ouais elle ferait mieux de partir. » Ou un truc comme ça. Et puis il s’est éloigné.
Clementine- Oui. J’interviens dans des situations violentes depuis que j’ai genre 18 ans, et j’ai commencé à faire ça en mode je traine dans la rue en étant alcoolisé·e, avec littéralement aucune idée de ce que je fais. C’est juste que je ne supportais pas de voir de la violence éclater devant moi. Et du coup, je suis toujours intervenu·e. J’ai fait ça énormément de fois et j’ai aucune formation, mais j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris au fil du temps. Pour moi, ça a plutôt été des situations comme celle avec Jay, des inconnu·es avec lesquels j’avais aucun lien, et très souvent, ça a été des situations de violence domestique. Je pense vraiment que j’ai l’œil pour les repérer, et voir quand c’est sur le point d’éclater. Souvent, je marche dans la rue ou quoi et je vois un couple en train de s’engueuler sévère et ce que je fais c’est que je m’arrête et je me mets en retrait. Je ne m’implique pas mais je regarde juste comment ça évolue pendant un moment. Et puis si ça commence à devenir violent physiquement – si les gens en viennent aux mains, si l’un·e attrape l’autre, læ pousse… alors là j’y vais. Pour moi, de manière générale il y a deux stratégies. Et je ne sais pas exactement comment je décide. C’est un peu intuitif j’imagine. Des fois, je parlerais plutôt à la personne visée par l’agression, en lui disant quelque chose comme « est-ce que ça va ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Est-ce que tu veux partir de là avec moi ? » Et d’autres fois j’irais directement vers la personne agressive, et je la regarderais droit dans les yeux et je lui dirais fermement, mais pas trop vénèr non plus « ça va pas se passer comme ça là. Il faut que tu te calmes. » C’est ce genre de chose que je dirais en général. Souvent, le simple fait qu’il y ait un·e témoin, quelqu’un·e qui s’implique, ça peut être suffisant pour que la personne se dise « Oulà, il y a quelqu’un·e d’autre dans l’histoire maintenant. C’est pas pareil que quand c’était juste moi en train d’attaquer cette personne. » Et ça la fait prendre du recul sur la situation. Pour moi, le but de tout ça, c’est simplement d’empêcher la violence de continuer, de la faire dés-escalader, et de donner à la personne visée par l’agression la possibilité de partir si elle le souhaite. Du coup, si je demande « tu as besoin de partir de là ? » Et que la personne me dit « Ouais faut que je me casse de là, » alors c’est mon boulot de dire « on part. » Et souvent c’est compliqué et flippant parce que dans pas mal de cas c’est un gars qui fait deux fois ma taille et qui est en mode « tu te fous de ma gueule ? Non tu pars pas. » Et moi je suis en mode « Si si, on part. » Et on part bel et bien. J’ai fait ça plein de fois et c’est flippant. Et c’est sûr que je me sens vraiment tendu·e quand je fais ça. Mais je pense que c’est important d’avoir en tête que c’est pas une performance. C’est pas un spectacle. C’est pas toi qui éduques cette personne ou qui cherches à lui faire honte, à aucun moment. Tu n’as pas besoin de te lancer dans des trucs chelous, des coups de gueule politiques. Tu n’as pas besoin d’insulter la personne qui est agressive ou de la traiter de tous les noms. Rien de tout ça ne sera aidant.
Jay- Et pas besoin non plus de faire tout un discours à la victime de la situation.
Clementine- Non, ça n’aide pas. Reste calme, reste ferme, et dis « ça ne va pas se passer comme ça et on va faire changer cette situation. » N’en fais pas des tonnes là-dessus. Je pense toujours à comment les gens sont too much dans la cancel culture – rien de tout ça ne serait aidant dans une seule de ces situations concrètes. Sérieux, c’est comme si –
Jay- Comme si c’était pas dans le monde réel.
Clementine- Oui, tout le monde est déjà hyper stressé et trigger et ça ne fait qu’envenimer les choses. Ton but c’est pas d’humilier les gens, ni de faire la morale aux gens, ton but c’est d’essayer de faire en sorte que la personne puisse partir de là si elle le veut. Des fois elle ne veut pas partir. Et c’est ok aussi. C’est pas à moi de dire à cette femme « tu n’as pas le droit de rester avec ton mec violent. » En fait c’est son putain de droit de faire ça. En temps que membre responsable de la société, c’est juste à moi de lui donner la possibilité de se barrer si elle le veut. Et c’est tout ce que je peux faire.
Jay- On peut aussi intervenir dans des relations déjà existantes, si on sent qu’il pourrait y avoir de l’abus. Mais en vrai, c’est très compliqué. Encore une fois, on ne peut pas forcer une personne à quitter une relation. En fait, c’est même très dangereux d’essayer. Par contre on peut dire très clairement à cette personne qu’on sera toujours là pour elle quoi qu’il arrive. On peut lui dire clairement que si jamais elle a besoin d’aide pour quelque raison que ce soit, elle peut venir nous voir. Et on peut essayer de l’aider à traverser la merde qu’elle vit. Genre si elle vit une situation de type syndrome de Stockholm, on peut essayer ensemble de débrouiller tout ça. Mais c’est un sujet compliqué et ça prendrait bien un épisode entier du podcast pour s’y plonger.
Clementine- Oui. J’ai l’impression que maintenant que tu as lancé le sujet, il faut que je dise quelques trucs là-dessus. Parce que je suis un·e survivant·e de violences domestiques, et je me suis aussi investi·e dans des groupes de survivant·es de violence domestique, en faisant du safety planningVIII. Du coup, j’ai beaucoup écouté des survivant·es de violence domestique parler de leurs expériences, et je sais beaucoup de choses là-dessus. Voilà quelques trucs importants si on sait qu’un·e de nos ami·es est pris·e dans une relation abusive. Et là, on parle bien d’une relation abusive, ça veut dire que notre ami·e est coincé·e et qu’iel ne peut pas partir, ok? Du coup iel vit des situations où sa·son partenaire fait usage de violence physique, de menaces, peut-être contre les enfants ou les animaux, et de plein de manières, rend ça tellement dangereux de la·le quitter que la personne ne le fait pas. Ce type de situation. Donc voilà quelques trucs clé, si on veut intervenir, ou juste soutenir la victime pour qu’elle puisse sortir de là.
Le truc c’est que, statistiquement, quand une personne quitte une relation violente, c’est là qu’elle a le plus de chances de mourir, parce que c’est le moment le plus probable où l’abuseur·e peut s’en prendre à elle de manière létale. C’est donc un moment extrêmement dangereux, alors mettre la pression à cette personne ou la pousser à partir, c’est pas une bonne idée. L’idée c’est plutôt d’aider la personne à faire un plan pour quitter la relation quand elle sera prête à le faire. Dire de la merde sur l’abuseur·e et être comme « cette personne est une grosse merde » tout le temps, ça va faire que la personne va arrêter de te parler de ce qui se passe. Alors si tu veux que cette personne se confie à toi, tu ne peux pas dire de la merde sur l’agresseur·e. Tu peux dire des trucs comme « je pense que c’est pas ok qu’il ait fait ça, » ou « je pense que c’est pas ok qu’on te parle comme ça. »
Jay- Oui, ou genre « Comment est-ce que ça t’a fait te sentir ? »
Clementine- Oui. Tu peux signaler que tu penses que les choses ne vont pas, et ça me semble une bonne chose à faire parce qu’on a tendance à normaliser les abus. Du coup, c’est ok de dire « ouah, c’est vraiment flippant. Ça n’aurait pas du se passer comme ça. » Mais ne pars pas dans des trucs excessifs du genre « quel sac à merde. » Parce que la personne est probablement en train de composer avec des sentiments complexes, à la fois d’amour et de crainte, et du coup, elle aura le sentiment qu’elle ne peut pas te parler de tout ça. Une des meilleures choses que tu puisses faire, si c’est possible, c’est de lui donner une clé de chez toi et de lui dire quelque chose comme : « tu peux t’en servir à n’importe quel moment, sans aucun problème, si tu as besoin de sortir de là et d’avoir un endroit où atterrir. » Voilà. C’est juste quelques conseils de base là-dessus. C’est un problème bien plus vaste que ça et je crois qu’on pourrait en parler longtemps.
Tout ça pour dire qu’on prend le fait d’intervenir dans les situations de violence très très au sérieux. C’est très important parce que la violence est abjecte et délétère. Tout le monde a le droit de vivre sans violence. Du coup, quand de la violence se manifeste dans nos communautés, on a la responsabilité éthique d’intervenir du mieux qu’on peut. Le mieux qu’on peut, c’est différent d’une personne à l’autre. Tout le monde ne sera pas à l’aise d’y aller et de s’impliquer de cette façon. Mais je pense qu’on devrait développer ces compétences, on devrait faire des ateliers sur la dés-escalade, on devrait s’apprendre et se former les un·es les autres à comment faire ces choses là. Et ça ferait tellement plus de choses pour la sûreté des communautés qu’aucun de ces trucs de cancel culture.
Jay- Grave, c’est pour ça que c’est tellement offensant quand les gens sous-entendent qu’être contre les conneries de la cancel culture c’est s’en foutre des survivant·es, s’en foutre des violences ou s’en foutre des agressions qui ont lieu. Parce qu’en vrai la cancel culture est complètement incapable de s’occuper d’aucun de ces trucs. Tu ne peux pas cancel quelqu’un qui pourrait tuer sa copine, merde ! Ça ne marche pas.
Clementine- Ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas.
Jay- C’est une idée complètement ridicule. Si tu vois quelqu’un qui est sur le point de frapper sa copine dans le métro ou un truc comme ça, tu ne peux pas le cancel pour empêcher que ça arrive_!
Clementine- Ouais, c’est absurde. Il y a un autre truc à propos de l’intervention dont je voulais parler avant qu’on change de sujet, c’est la question des flics. En général… appeler les flics est une décision qui peut avoir d’énormes conséquences pour les personnes impliquées, y compris pour la personne qui est la cible de l’agression. Je conseillerais de ne pas appeler les flics. Et ça peut être délicat, parce que si tu entends ta·ton voisin·e crier, tu peux te dire « bordel, je vais appeler les flics. » Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, la victime des violences est mise en cause au même titre, voire à la place, de la personne qui inflige réellement la violence. Il peut aussi y avoir d’autres problèmes, si la personne n’a pas de papiers par exemple, ce qui la met encore plus en danger si la police est impliquée. Ça peut vraiment être compliqué et difficile. Devant la violence, beaucoup de gens se disent que c’est ça intervenir. Mais les flics sont armés et font peur et font souvent augmenter le niveau de violence. Ils n’ont aucune compétence en matière de désescalade.
Jay- Non, ils n’ont littéralement aucune formation pour faire ça. Et quand j’étais travailleur·euse social·e, ça me faisait péter un câble. Parce qu’il suffisait qu’ils se pointent et la situation escaladait immédiatement de dix mille degrés. Souvent, ils se contentaient d’embarquer un type qui se comportait mal avec une zonarde par exemple, et huit heures plus tard il était de retour et il lui éclatait la gueule, tu vois ?
Clementine- Oui, ça n’a aidé personne. C’est un truc à avoir en tête pour les personnes qui commencent tout juste à bosser sur ces questions, que les flics ne sont pas toujours une stratégie efficace.
Voilà ce qu’on pouvait dire sur l’intervention. Le dernier truc dont on voulait parler, c’est la punition. Dans la cancel culture et les injonctions à rendre des comptes, je ne crois pas que les personnes admettent ouvertement qu’elles essaient juste de punir les gens.
Jay- En général non. Mais l’expression « rendre des comptes » est littéralement une façade pour ça, donc la plupart du temps c’est ce qui se passe quand même.
Clementine- Personne n’admet ça ouvertement, mais très souvent, c’est ça qui se passe : on punit quelqu’un·e. Je trouve que la moindre des choses, ça serait que les gens soient honnêtes là-dessus. Si je ne peux pas convaincre les gens que la punition est une mauvaise chose, au moins j’aimerais que les gens soient honnêtes et cessent de faire l’amalgame entre l’intervention et la punition.
En gros, la punition enfreint les limites d‘une personne parce que cette personne a violé les limites de quelqu’un·e par le passé, ou a été accusée de l’avoir fait… C’est basé sur le fait de retirer aux gens leur droit à avoir des limites. On voit très souvent ces situations où le fait que quelqu’un soit, je cite, « un·e agresseur·e notoire » veut dire que tu peux juste faire ce que tu veux à cette personne. Tu as le droit de la harceler, tu as le droit d’essayer de la faire virer de son taf, tu as le droit de dire à tous ses ami·es de ne plus être ses ami·es. Tout est permis. Et pour moi, c’est une énorme violation des limites et de l’autonomie de cette personne.
Jay- La question c’est, comment est-ce qu’on justifie ça ? Il ne s’agit pas d’intervenir pour tout et n’importe quoi.
Clementine- C’est ça. La logique de la punition c’est les représailles, c’est que la personne mérite ça parce qu’elle a fait quelque chose de mal. Et pour moi, c’est une logique très dérangeante, parce que ça veut dire qu’on est défini·e pour toujours par les pires choses qu’on ait faites, et ça nous donne juste zéro envie de prendre nos responsabilités ou de changer, parce que, à quoi bon ? Si on sera toujours défini·e par la pire chose qu’on a faite, et qu’on doit encore et encore, être puni·e pour ça, alors à quoi bon changer ? Pourquoi faire tout ce travail hyper difficile pour changer si on sait que pour tout le reste de notre vie, les gens vont dire qu’on est un violeur, et ne nous laisseront jamais faire partie d’un groupe, ni avoir une nouvelle relation…
Jay- Ni bosser dans un foutu café par exemple.
Clementine- Ni vivre sans être harcelé·e. Les gens sont à cran sur ce sujet, et sont vénèr que j’essaie de tendre autant de compassion et d’humanité à des gens qui sont peut-être des violeurs ou qui ont commis des violences graves sur d’autres personnes. Ou même dans des dépassements de limites plus anodins. Et ils pensent que ça veut dire que j’en ai rien à foutre des survivant·es. Et c’est tellement faux. Je suis un·e survivant·e. La vie des survivant·es me tient profondément à cœur. C’est incroyablement important que les survivant·es reçoivent le soin dont iels ont besoin pour guérir. Je pense que ce qui leur est arrivé n’aurait pas dû arriver. Je pense qu’intervenir dans les situations de violence est super important. Et je pense que punir les gens, ça ne fait rien pour créer de la justice, ça ne fait rien du tout pour transformer la situation. Ce que ça produit vraiment, c’est encore plus de violence, plus de violations de limites. Ça blesse plus de gens. Et ça ne redonne rien à la personne dont les limites ont été violées ou qui a été blessée au départ.
Jay- Et en général ça rend presque impossible le fait de commencer à travailler sur soi pour la personne mise en cause, sauf s’il se trouve que c’est quelqu’un·e qui a particulièrement la tête sur les épaules et un tempérament solide. Je veux dire, si on est en train de vivre une campagne de dénonciation terrifiante, où on a perdu tou·te·s nos ami·es, notre taff, etc, comment est-ce qu’on va pouvoir être suffisamment stable pour commencer à se poser des vraies questions sur notre comportement ? Disons que tu es une personne qui en a agressé une autre par exemple. La plupart des gens qui font ça ne sont pas genre, des monstres détraqués. Iels peuvent tout à fait changer. Comment est-ce qu’on leur fait comprendre ça ? Par cette campagne de punition ? Il y a peu de chances.
Clementine- Oui. Et puis dans l’idée de soutenir les survivant·es, j’en ai vraiment marre de l’opposition agresseur·e/survivant·e. C’est un truc avéré que les survivant·es de graves violences dans l’enfance deviennent souvent addict·es et agissent souvent de plein de manières fuckées et complètement dingues. Plein de personnes qui commettent des violences quand elles sont bourrées et défoncées sont des survivant·es de violences dans l’enfance. Et j’ai une compassion immense pour elles. Ce sont des survivant·es d’abus dans l’enfance. Iels méritent de la compassion et d’avoir l’opportunité de guérir et de se remettre de leur trauma complexe. Ces personnes ne sont pas juste agresseur·es, elles sont aussi survivant·es. Et je pense que c’est vrai pour un paquet de gens. Par ailleurs je suis pour l’abolition de la prison. C’est fondamental, je ne crois pas en la punition. Je ne crois pas en la prison. Le postulat de base de la prison, c’est de violer les limites de quelqu’un·e de la manière la plus profonde qui soit en lui retirant sa liberté et en l’enfermant. De lui retirer son autonomie physique aussi radicalement que possible pour læ punir de quelque chose qu’iel a fait. Je pense que c’est abject et complètement déconnant. Faire une version light de ça, dans une communauté où on n’enferme pas cette personne dans une cellule mais où on lui retire tout ce qu’il y a de bien dans sa vie, où on l’empêche d’aller de l’avant, d’avoir une communauté,ou d’avoir dans sa vie des choses qui pourraient l’enthousiasmer et qu’elle pourrait aimer, c’est vraiment hardcore comme punition. Et je ne suis vraiment pas d’accord avec ça. Je pense que les gens ont le droit d’avoir de belles vies, pleines et entières même quand ils ont merdé et fait des trucs horribles.
Jay- C’est clair. Bien sûr, se faire cancel ça n’est pas la même chose que de se faire incarcérer, mais ça partage la logique carcérale dans le sens où c’est punitif – basé sur la punition.
Clementine- Les deux violent l’autonomie des gens. De manières totalement différentes – je ne fais pas l’amalgame et je ne dis pas que c’est la même chose. Mais les deux violent les limites des gens. Nous on est abolitionnistesIX. Mais beaucoup de gens qui se disent abolitionnistes disent « on est abolitionnistes donc on ne croit ni dans le système carcéral étatique, ni dans le fait de violer les limites des gens très très gravement comme le fait ce système. Par contre, on croit dans le fait de violer les limites des gens d’une manière moins grave, dans un cadre communautaire. C’est moins pire parce que les gens ne sont ni incarcérés ni à la merci de la violence policière. »
Jay- Et tu n’as pas vraiment de date de procès ni d’avocat. [rires]
Clementine- Exactement. Définitivement, je ne dis pas que c’est la même chose, mais c’est quand même hyper déconnant. Violer les limites des gens, ne pas les autoriser à avoir une vie et les définir en permanence par ce dont ils ont été accusés, ou par les pires choses qu’ils ont jamais faites – c’est une punition. C’est une logique punitive et selon moi, ça ne va pas du tout.
Jay- Tout à fait. Et – Okay, juste avant qu’on passe à la dernière partie, il y a un truc qui me vient en tête et je vais essayer de l’exprimer. C’est qu’il y a une origine à ce qu’on a appelé « justice transformatrice », « justice restauratrice », à ces modèles là de responsabilisation, qu’on fait souvent remonter à un milieu précis, spécifique, très nettement d’influence Noire, qui fait très « organisation communautaire à l’américaine. » J’ai dans l’idée que ça vient du Midwest, des quartiers pauvres de Chicago. Et ce que je trouve tellement offensant c’est que des gens qui n’ont absolument aucun lien avec quoi que ce soit qui ressemble à ce milieu d’origine utilisent du langage qu’ils ont tiré de là, pour justifier leurs propres comportements merdiques. C’est comme si iels se cachaient derrière l’idée que ce qu’iels font c’est un truc progressiste d’organisateur·ice communautaire Noir·e – et aussi parce que ce sont des identitaristes* – donc c’est forcément bien et bon. Dans le fond iels s’accaparent ce travail mené par d’autres personnes et qui, j’imagine, part de bonnes intentions, et s’ancre souvent dans un vrai cadre abolitionniste dans lequel elles se demandent « comment pouvons-nous mettre un terme aux cycles de violences perpétrés au sein de nos propres communautés ? » Iels prennent ce cadre et les mots qui y sont associés et l’appliquent à des formes de comportements complètement différentes qui n’ont rien à voir avec ce à quoi c’est censé s’appliquer. Iels font genre que, par exemple, engueuler quelqu’un·e sur Internet jusqu’à ce qu’iel mette fin à ses jours c’est la même chose qu’une session de médiation, à laquelle participent quelques voisin·es, quelques figures respectées de la communauté et un prêtre de l’église qu’il a fréquenté enfant, pour essayer de faire en sorte qu’un jeune qui s’associe à des gangs cesse de perpétrer des violences envers les femmes qui l’entourent. Tu vois ce que je veux dire? Ça n’a rien à voir, non ? Et franchement je trouve que c’est très raciste que les gens continuent d’essayer de faire ça. Ça m’énerve beaucoup et je n’avais pas réussi à le formuler jusqu’à aujourd’hui, mais je pense que c’est un truc important à dire.
Clementine- Oui. J’ai envie de sauter sur l’occasion et d’ajouter quelque chose qui est lié. Dans toutes sortes de communautés humaines à travers l’histoire, il y a eu des gens qui ont agi de manières qui enfreignent les limites d’autres personnes.
Jay- Littéralement dans l’histoire de toutes les communautés humaines.
Clementine- Du coup ça veut dire qu’il y a eu plein, plein, plein de tentatives de prendre ça en charge. Il y a eu plein de tentatives de prendre en charge le genre de choses qu’on vit maintenant.
Jay- Presque une infinité
Clementine- Et il y a eu beaucoup de tentatives de faire ça sans compter sur la police, des tentatives de créer des réactions saines qui transforment la situation et aident toutes les personnes impliquées. Je suis sûr·e qu’on verrait qu’il y a eu beaucoup de tentatives différentes dans beaucoup de contextes différents si on se penchait sur la question. Je suis sûr·e que c’est arrivé plus d’une fois.
Jay- Oui, tout à fait. Et en tant que foutu·e anthropologue6, je peux vous dire avec certitude qu’il y a des milliers, et des milliers, et des milliers de manières différentes d’essayer de résoudre les conflits.
Clementine- Bien sûr. Mais ce qui se passe sur internet, c’est que les gens présupposent que tout est dans la lignée du mouvement dont tu parlais, que tout commence avec ça, avec cette image du monde américano-centrée cheloue que les gens ont sur les réseaux sociaux, où ils partent du principe que de tous temps, les États-Unis ont été à l’origine de tout. Pour être honnête, je ne connais pas grand chose de ce mouvement. Je peux nommer quelques uns des livres et quelques un·es des penseuses·eurs – un livre qui me vient à l’esprit c’est The Revolution Starts at Home 7. Je pense qu’il est emblématique de ce dont tu parles, notamment en ce qui concerne les termes de « justice restauratrice » et de « justice transformatrice. » Mais en gros, quand on commence à parler de résolution de conflits, de prendre ses responsabilités et de ce que ça veut dire de rendre des comptes, les gens partent du principe que tout ce qu’on dit est dans cette lignée là. Et je suis sûr·e que c’est influencé par ça, juste parce qu’on est sur internet et dans ces milieux. C’est aussi des discours qui sont présents plus largement que dans ces cercles depuis un temps. Par exemple, c’est sûr que j’ai entendu parler du terme « justice transformatrice », et que je sais des choses là-dessus. Mais en fait, pour moi – et je pense que je peux aussi parler pour toi Jay – les connaissances qu’on a ne viennent pas de là. Elles viennent spécifiquement de nos vécus d’addict·es ayant commis des violences, ayant été témoin de violences, ayant été victimes de violences, étant intervenu·es pour mettre fin à des violences, et ayant fait l’expérience des 12 Étapes. C’est des 12 Étapes qu’on tire la majorité de notre savoir sur le fait de prendre ses responsabilités. Ça vient de là. Et c’est un modèle différent de celui qui est mis en avant par les penseur·euses de la justice transformatrice. Je pense que ça se rejoint sur des bouts, c’est sûr. Parce c’est des idées un peu évidentes que plein de gens ont probablement eues. Mais la lignée dans laquelle on se situe est particulière, et bien qu’elle soit américaine au départ, ça vient de cette bande de types des années 30 qui ont écrit ce livre8 qu’on a lu plein de fois.
Jay- Oui. Une bande d’anarchistes chrétien·nes9.
Clementine- Oui. Du coup on s’inscrit dans cette lignée là, et on sait ces trucs là parce qu’on les a pratiqué pour de vrai, plein de fois. Être parrain·marraine10 pour les gens, travailler avec elleux sur le fait de prendre ses responsabilités, et tout et tout. Alors ça me fait un peu chier, parce qu’en fait tout le monde n’est pas dans la même lignée, et différentes personnes ont bossé là-dessus à travers l’histoire, littéralement partout dans le monde. Et chacune a des choses à offrir, mais toutes ne sont pas identiques.
Jay- Oui. Mettre sur le même plan toutes les réponses possibles à un conflit et prétendre que le truc que tu es en train de faire doit être la même chose que genre, ce qu’ont fait et continuent de faire des femmes Noires militantes à Chicago par exemple c’est raciste et nul.
Clementine- Et puis, je ne vais parler que des penseurs·euses que je connais, non ? Honnêtement, j’ai quelques uns de ces livres dans ma bibliothèque. J’ai commencé à lire The Revolution Starts at Home. Je suis un·e grand·e fan de Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha et je connais son travail. Mais je n’ai pas lu ce livre en entier. Il est sur ma très longue liste de lecture. Alors ce serait bizarre que je m’y réfère.
Jay- Je parierais aussi que 99 % des personnes qui portent ce discours ne l’ont pas lu non plus.
Clementine- C’est un livre important, et je pense qu’on devrait tou·te·s le lire. Mais ça serait malhonnête de ma part de dire que ma pensée vient de ce livre, parce que ce n’est pas de là que mes pensées viennent. Pour être honnête, elles viennent plutôt du Gros Livre des Alcooliques Anonymes. [rires]
Jay- Oui. On va juste ajouter un dernier truc, c’est que souvent dans le Nexus, les gens sont en mode « Ce que tu vis, ce n’est pas de l’ostracisation ; ce sont juste les conséquences de tes actes. » On voulait dissiper cette idée reçue et parler brièvement de la différence entre conséquences et punition.
Clementine- Oui. Parce que ce sont deux choses différentes. Les conséquences sont ancrées dans le réel. Quand on fait certains choix, ils ont certains résultats. Et ces résultats ne sont pas toujours des trucs positifs ou qui nous font plaisir. Dans les contextes interpersonnels, il y a deux sortes de conséquences, l’une est liée aux limites personnelles, et l’autre à des interventions localisées. Un exemple de conséquence liée aux limites personnelles, ça peut être : disons que je commence à écrire ouvertement sur le fait que je m’oppose à la cancel culture sur internet. Quelques fans, qui croient très fort à la cancel culture, peuvent choisir de ne plus soutenir mon travail. Iels peuvent choisir de ne plus me suivre. Iels peuvent choisir de ne plus acheter mes zines, parce qu’iels sont en désaccord profond avec ce que je dis. C’est complètement ok et normal. C’est leur droit. C’est leur limite. Iels ne veulent pas soutenir un·e penseur·euse avec læquelle iels ne sont pas d’accord. Ok. Iels peuvent même écrire un texte dans lequel iels expriment leur désaccord et contredisent mes idées. Un autre exemple de conséquence liée à des limites personnelles ça serait, disons que j’ai dit d’accord pour ne pas crier quand on se dispute et que je l’ai quand même fait plein de fois. Alors la personne qui a posé cette limite avec moi me dit « je vais laisser tomber cette relation, parce que tu as franchi ma limite plein de fois. » J’ai franchi les limites de quelqu’un·e un paquet de fois, iel ne veut plus être en relation avec moi. C’est une conséquence.
Un exemple d’intervention localisée ça serait – oh, mais oui, tu avais un bon exemple de ça.
Jay- Ah oui. Pendant les permanences des Programmes en 12 Étapes, il y a un·e trésorier·ère qui gère l’argent. Et c’est un rôle important. Il faut faire passer le chapeau à tout le monde, compter les poignées de monnaie qu’il y a et après on les met dans une boîte qu’on ferme à clé et qu’on range en lieu sûr. On a besoin de cet argent pour acheter du café et payer le loyer du sous-sol de l’église. Mais des fois des gens volent l’argent parce que c’est un groupe de foutus alcooliques et ça nous arrive de faire des trucs comme ça. Ça nous arrive de replonger et d’être en mode « j’ai vraiment besoin de me la coller donc je prends cet argent. » Ça arrive. Dans une situation comme celle-ci une intervention localisée serait : Tu as volé de l’argent ? Alors tu n’as plus le droit d’être trésorier·ère.
Clementine- Oui, On voit que ça a du sens. Ces conséquences sont liées à l’acte et spécifiques au contexte. Peut-être qu’on ne fera pas confiance à cette personne pour s’occuper de l’argent pendant un temps, le temps qu’elle ré-établisse des relations de confiance. Vu qu’elle a fait quelque chose qui a brisé la confiance des autres dans sa capacité à gérer l’argent. C’est une conséquence naturelle. Et d’un autre côté, la cancel culture n’est pas une conséquence parce qu’un petit groupe de personnes – ou parfois un plus grand groupe de personnes – se sert du harcèlement pour forcer les autres à faire les mêmes choix qu’elles.
Jay- Oui. Ou pour les forcer à se soumettre à leur propre vision du monde.
Clementine- On va un peu décortiquer ça. Prenons l’exemple que j’ai donné, « Ok, Clementine a dit ouvertement ne plus aimer la cancel culture alors je vais arrêter de suivre Clementine sur les réseaux. » C’est ton choix. Et peut-être que toi et trente autres personnes allez arrêter de me suivre sur les réseaux, de votre propre volonté. Ou peut-être même un millier d’autres personnes. Mais si tu fais un post qui dit « Clementine Morrigan est une grosse merde qui ne soutient pas les survivant·es parce qu’iel dit que la cancel culture c’est de la merde. Pourquoi mes followers suivent encore Clementine Morrigan ? C’est à vous que je parle. » Et là tu tagues les dix personnes que tu suis qui me suivent… Ce que tu fais c’est que tu les intimides pour qu’elles fassent ce que tu veux. Tu les harcèles sur internet. Tu les affiches publiquement, et tu ne leur laisses pas la possibilité de prendre leur propre décision par rapport à ce qu’elles pensent de mon travail. C’est de la coercition. Et beaucoup de gens prennent part à ces campagnes de cancellation passivement, parce qu’ils se disent, « je ne veux pas me faire harceler. »
Il y a pas longtemps, quelqu’un·e que je connais sur les réseaux a été cancel. J’ai reçu quinze messages de personnes random – certaines que je connais, d’autres que je ne connais pas – en une seule journée. Me disant, « j’ai remarqué que tu suis cette personne. Cette personne a dit des trucs vraiment craignos sur twitter. Je me demande juste pourquoi tu te dis que c’est ok de la suivre. » Mais c’est tellement déplacé ! Ça c’est pas une conséquence. Une conséquence ça serait que moi, de ma propre volonté et avec mon libre-arbitre, je me dise « En fait je suis pas à l’aise avec ça, je vais arrêter de suivre cette personne. » Mais j’étais pas mal à l’aise. Je n’avais pas envie d’arrêter de suivre cette personne sur les réseaux. Et je pense aussi que je n’ai pas à arrêter de suivre quelqu’un·e juste parce qu’iel a dit quelque chose avec quoi je ne suis peut-être pas d’accord. Ça n’est pas de cette manière là que je suis ou pas les gens sur les réseaux. Je permets aux gens d’avoir des opinions diverses, certaines que je partage et d’autres pas.
Jay- Oui. Au fait, on peut être ami·e avec des gens avec qui on n’est pas d’accord. J’ai juste envie de poser ça là au cas où des gens ne seraient pas au courant. [rires]
Clementine- Oui. Et personnellement, je choisis de le faire. Et puis peu importe, mais je ressentais pas le besoin d’arrêter de suivre cette personne. Quand il y a des personnes qui par la coercition et l’intimidation en forcent d’autres à participer à une ostracisation, ce n’est pas une conséquence naturelle. La cancel culture ça marche comme ça. C’est une campagne dans laquelle on n’attaque pas seulement la personne qui est cancel mais aussi tou·te·s ses ami·es et soutiens jusqu’à ce qu’elleux aussi cancellent la personne. C’est pas seulement une conséquence passive des actes de la personne. Si on les laissait juste penser librement, beaucoup de gens penseraient beaucoup de choses différentes. Certaines personnes diraient juste « bof, je m’en fous un peu de ça alors je ne vais pas changer de comportement. » D’autres diraient « ouah mais ça me parle trop, je soutiens cette personne et ce qu’elle dit. » D’autres seraient en mode « non, ça me parle pas et ça me fait péter un câble, je vais arrêter de suivre.» Et il y aurait tout un éventail de réactions. Mais la cancel culture écrase tout ça par la punition et ne permet pas aux gens de faire des choix différents.
Jay- Oui. Voilà, c’est à peu près tout. Désolé·e que cet épisode ait été aussi long !
Clementine- Merci d’être resté·es avec nous tout au long de cette discussion chargée et intense. Je suis sûr·e que ça a soulevé un paquet de trucs pour plein de monde. Je suis sûr·e que ça a trigger plein de monde. C’est vraiment contre la pensée orthodoxe et je pense que pour beaucoup de personnes qui ont survécu à de la violence, entendre dire qu’il faudrait faire preuve de compassion envers des personnes qui commettent des violences ça peut être très très trigger. Mais soyez sûr·es qu’on déteste la violence et qu’on pense que les trucs horribles qui vous sont arrivés ne sont pas du tout ok, et sont injustes et qu’on aurait voulu que ça ne ne vous soit pas arrivé. Ce qu’on veut c’est construire un monde où toute cette merde n’arrive pas. On est intensément engagé·es pour faire cesser la violence, et c’est pour ça qu’on travaille de près et personnellement avec des personnes qui ont commis des violences et franchi les limites des autres, et qu’on les aide à faire le travail de guérison dont iels ont besoin pour ne plus faire ça. Et on sait que les humilier, leur faire la morale et leur enlever leur communauté ne les aidera pas à faire ce travail.
Jay- Et, à terme, le genre de monde dans lequel on n’a réellement pas besoin de prisons, le genre de monde dans lequel on peut abolir la police pour de vrai – parce que ce n’est pas le monde dans lequel on vit aujourd’hui, soit dit en passant – est un monde socialiste*. Et nous ne pouvons pas construire le socialisme alors que la gauche est aussi fragmentée, dysfonctionnelle, et incapable d’avancer. C’est pour ça que c’est important pour nous de critiquer la gauche : nous voulons une gauche fonctionnelle afin de construire le socialisme, pour que la violence ne soit pas une chose à laquelle autant de gens sont si souvent confrontés. On le pense sincèrement. Et si tu veux abolir la police, tu sais, je suis carrément pour. J’ai souvent eu à bosser avec la police quand je travaillais dans les foyers et c’était vraiment de la merde. Iels sont vraiment nul·les dans leur travail. Iels font tout empirer. Mais si on se débarrassait de la police aujourd’hui, dans notre société actuelle extrêmement hiérarchique et capitaliste, on se retrouverait juste avec des putains de capitalistes qui ont des armées privées, tu vois ? On doit construire le socialisme pour pouvoir se débarrasser de la police en vrai. Et on ne peut pas construire le socialisme quand la gauche est juste un mélange de postures esthétiques et de cancel culture.
Été 2021, Montréal, Québec pour la version originale.
Notes
(1) « le Nexus » est le terme qu’on utilise pour décrire le croisement de la cancel culture*, de l’identitarisme* de gauche et des réseaux sociaux, qu’on perçoit comme se renforçant et interagissant les un·es avec les autres pour produire certaines propriétés et caractéristiques émergentes. À cette intersection se trouve le phénomène appelé de diverses manières social justice culture, wokeworld, radlibs, etc.
(I) [les notes en chiffres romains sont des notes de traduction] « Nik la police ça veut dire qu’on n’agit pas comme des flics les un·es avec les autres »
(2) Comme l’explique Sarah Schulman dans son livre Le conflit n’est pas une agression.
(3) Dans les programmes en 12 étapes, les gens sont encouragés à réparer les torts qu’ils ont causés via un processus nommé « faire amende honorable. »
[Ndt] En français, le texte qui sert de base à ces programmes a traduit ce concept par « réparer nos torts. » Nous traduisons par l’un ou l’autre. « Faire amende honorable » signifie « changer les choses en vue de les améliorer. »
(II) Étapes du programme en 12 étapes.
(III) proposition de traduction de « fawn response ». Il s’agit de l’un des 4 archétypes des réactions traumatiques. La réaction de sujétion se traduit par le fait de se mettre au service des autres, en se coupant de soi-même, notamment dans des situations où les gens sont maltraitants. C’est un comportement de survie inconscient qui permet parfois d’éviter de s’exposer à de la violence, notamment dans les situations de violence domestique et intra-familiale.
(IV) on peine à trouver une traduction fidèle à « people-pleaser. » Ça désigne une personne qui fait tout pour être appréciée par les autres, y compris des choses qui ne lui plaisent pas à elle. Ce comportement peut parfois être lié à une réaction traumatique de sujétion.
(V) « people-pleasers »
(VI) réaction habituelle du système nerveux à une situation qu’il identifie comme dangereuse : le système nerveux redirige alors notre énergie vers les parties du corps qui ont besoin d’être mobilisées pour se défendre ou pour fuir. Cela inclut, entre autres, une forte montée de cortisol, l’hormone du stress. Dans cet état, il est très difficile d’être capable de faire autre chose que combattre ou fuir, autant d’un point de vue rationnel qu’émotionnel.
(4) c’était dans le podcast Multiamory. Mais malheureusement, je ne me rappelle pas quel épisode.
(VII) nous utilisons le mot anglais car il nous semble être utilisé assez couramment en français. Il s’agit de l’état dans lequel on se trouve lorsqu’un événement ou une expérience déclenche ou redéclenche une réaction traumatique.
(5) la théorie de l’attachement est un champ d’étude en psychologie qui s’intéresse aux différents « styles » qui existent dans les attachements que les personnes nouent avec les autres. Cette théorie avance que les expériences d’enfance déterminent souvent les styles d’attachement des gens, ce qui les suit à l’âge adulte et impacte leurs relations. On en parle plus dans l’épisode 16 du podcast – « Fucking Feelings: Attachment Theory and the Nexus »
(VIII) Il s’agit d’un protocole qui aide à mettre en place des choses pour se mettre au maximum en sécurité lorsqu’on est victime de violences domestiques, qui aide à évaluer le danger et donne des pistes pour quitter la relation en prenant le moins de risques possible.
(IX) pour l’abolition de la prison et du système carcéral.
(6) Jay a passé trop de temps à l’école et a un diplôme d’anthropologie culturelle.
(7) 2016, Publié par Ching-In Chen, Jai Dulani et Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha.
(8) le « Gros Livre » des Alcooliques Anonymes.
(9) Les fondateur·ices des Alcooliques Anonymes étaient influencé·es par un mouvement spirituel chrétien qui insistait fortement sur les relations non-hiérarchiques, l’entraide, et l’importance d’une relation personnelle à dieu, indépendante des églises et du clergé.
(10) dans les programmes en 12 étapes, les gens qui sont là depuis plus longtemps peuvent être « parrain·marraine », et avoir un rôle de mentor pour de nouvelles·eaux arrivant·es en les aidant à traverser les étapes.
Liens vers le travail de Fucking Cancelled et des personnes qui font ce podcast (en anglais):
- https://patreon.com/fuckingcancelled
- https://fuckingcancelled.bigcartel.com
- https://fuckingcancelled.libsyn.com
- https://instagram.com/clementinemorrigan
- https://instagram.com/dominophagy
- https://clementinemorrigan.com
- https://clementinemorrigan.substack.com
- https://jaylesoleil.com
Traduction francophone, illustrations et édition par le collectif Vaisseau Papier en 2023-2024
Publication mai 2024